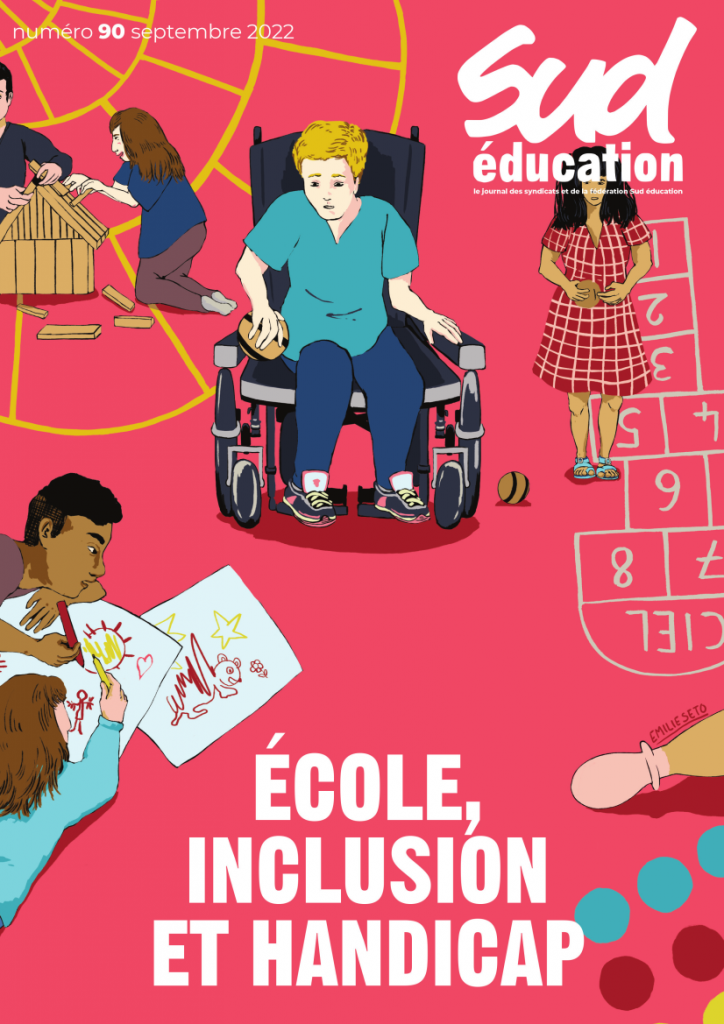Edito
La question du handicap à l’école recouvre trois réalités : celle de la scolarisation des élèves handicapés, celle des personnels handicapés de l’Éducation nationale et celle des personnels AESH, médico-sociaux et des enseignant·es, CPE, AED qui travaillent auprès d’élèves handicapés.
Alors que le ministère de l’Éducation nationale a fait de l’école inclusive une vitrine de son action, cette brochure d’information syndicale a pour objectif de dresser un bilan de l’école inclusive et de réfléchir aux luttes qui la traversent. Qu’est-ce que l’école inclusive aujourd’hui ? Que devrait être une école réellement inclusive? En quoi les conditions de scolarisation des élèves et des étudiant·es handicapé·es conditionnent leur avenir professionnel ? Comment sont traité·es les personnels en situation de handicap au sein de l’Éducation nationale? Toutes ces questions nous conduisent à remettre en cause le validisme qui traverse la vie en société pour mieux le combattre.
De plus, pendant longtemps, l’institution a englobé sous le vocable « d’élèves à besoins éducatifs particuliers » les élèves handicapés, les élèves allophones et les élèves en grande difficulté scolaire en développant pour les accueillir au sein de l’école dans des classes spécifiques avec des enseignant·es spécialisé·es puis dans des dispositifs dits d’inclusion scolaire. Aujourd’hui l’inclusion scolaire fait davantage écho dans la politique ministérielle au handicap, laissant dans l’ombre les élèves allophones et les élèves en grande difficulté scolaire. On pourra toutefois penser, dans cette brochure, aux mécanismes communs à l’œuvre dans les dispositifs de scolarisation des élèves handicapés, des élèves allophones et des élèves en grande difficulté scolaire.
À SUD éducation et dans cette brochure, on utilise les termes de “personne en situation de handicap” ou de “personne handicapée”.
Bonne lecture !
Sommaire
Dossier - Histoire d’une école pas vraiment inclusive
La problématique de la Troisième République
Les filles et le système scolaire français : une intégration longue et laborieuse
L’école de Jules Ferry : colonialiste et raciste
Le développement de l’enseignement spécialisé
Le défi d’une école vraiment inclusive
Depuis la loi de 2005 : quel changement ?
Dossier - Quelles revendications pour les personnes handicapées à l’école ?
Interview de militant-e-s du CLHEE
Retour sur la mobilisation pour l’école inclusive dans le 44
Une école inclusive, qui pourrait être contre ?
AESH : un accompagnement très précaire
Étudiant·es et personnels en situation de handicap dans l’ESR
Dossier - Les personnels handicapés : droits et conditions de travail
Droits des personnels en situation de handicap à l’Éducation nationale
Conditions de travail des personnels en situation de handicap
Dossier : Précarité et handicap : de l’école au monde du travail
Précarité et exploitation au travail
L’école, antichambre de l’exploitation ?
En Italie, «inclusion» signifie économie, précarité et privatisation
Entretien avec le collectif handi-féministe des Dévalideuses
Dossier - Les dispositifs d’inclusion scolaire
Boite à outil
Nos revendications
Histoire d’une école pas vraiment inclusive
Afin de mieux comprendre les enjeux qui se posent à nous, professionnel·les de l’éducation, aujourd’hui dans une école que l’on souhaite inclusive, il convient de revenir sur les grandes étapes historiques qui ont marqué, fondé, ancré, depuis l’Antiquité, notre rapport à la norme, à la différence, à l’école comme dans la société.
C’est en effet cette histoire qui modèle nos représentations et ces représentations impensées, ces préjugés, influencent immédiatement la manière dont nous envisageons aujourd’hui l’école inclusive, depuis ses modalités de mise en œuvre jusqu’à sa simple possibilité.
Cette histoire est une histoire de la norme, de la difficulté et de l’échec. C’est l’histoire des rapports que nous entretenons avec ces idées. C’est une histoire du regard que nous portons sur la diversité, sur la singularité.
On sait que dans l’Antiquité grecque et romaine déjà, les catégorisations d’êtres humains étaient effectives (Quentin, 2013), en fonction d’un écart à une norme physique et/ou morale, ce qui impliquait diverses réactions du groupe d’appartenance :
- la difformité congénitale était exposée sur la place publique,
- la folie était cachée,
- l’infirmité acquise (blessures de guerre par exemple) était quant à elle déjà soignée et parfois prise en charge par le groupe.
Au début du Moyen Âge, des hôtels-Dieu sont créés pour accueillir les infirmes et les pauvres de la société. A partir du 14ème siècle, l’exclusion des personnes handicapées est nourrie par la peur, les gens enferment et mettent à l’écart cette catégorie de la population.
En 1656, Louis XIV ordonne la création à Paris de l’Hôpital Général, la Salpêtrière, destiné au « renfermement » des mendiants. Une vingtaine d’années plus tard, une annexe est ajoutée pour y loger les jeunes filles dites dépravées, les femmes punies et les enfants fugueurs. En 1670, Louis XIV crée aussi l’institution des Invalides, chargée d’accueillir ses soldats invalides ou âgés.
Au cours du 17ème siècle, deux dates marquent l’implication de l’Etat envers les personnes les plus fragiles :
- 1790 avec l’affirmation du principe du devoir d’assistance par la Nation devant l’Assemblée constituante, par le Comité de mendicité présidé par La Rochefoucauld-Liancourt,
- 1796 avec la reconnaissance du « droit des pauvres » et la création des bureaux de bienfaisance dans les communes.
Peu à peu, la norme biologique, médicale s’installe: la science s’intéresse à « l’anormal » pour comprendre le « normal ». On assiste à la fois à une curiosité tout autant qu’à une défiance sociétale.
Les 18ème et 19ème siècles marqueront l’avènement des scientifiques portés par les philosophes des Lumières. Les médecins contrôlent et garantissent la norme sociale, elle-même définie à partir des normes de santé.
C’est une période de développement important des institutions spécialisées : asiles, hôpitaux… On explique la maladie mentale comme une forme de dégénérescence associée à certains milieux (les pauvres) et certaines dérives (alcoolisme…).
La norme universelle du genre humain, devient peu à peu celle de « l’homme blanc, riche et bien portant ». L’on voit alors apparaître des dérives théoriques eugénistes et racistes appuyées sur cette norme dite universelle justifiant, entre autres, l’exploitation coloniale.
Alexandre Ployé, maître de conférence à l’INSPE de Créteil, propose un découpage historique en trois temps, que nous reprenons : un premier temps autour de la Troisième République, époque charnière au cours de laquelle émergent des théories qui justifieront la mise à l’écart d’une partie des élèves, un second temps autour d’un grand XXème siècle, jusqu’aux lois de 2005 et 2009, où se développe l’enseignement spécialisé, et un dernier temps que nous vivons actuellement où nous essayons de construire une école dite « inclusive ».
La problématique de la Troisième République
Le constat est le suivant : proposer la même école à tou•te•s, de manière monolithique, n’uniformise pas les résultats. Les enfants n’apprennent pas tou•te•s de la même manière et cela s’oppose au projet républicain dans son principe d’universalité supposé à l’école mise en place suite à l’anéantissement du projet émancipateur de la Commune. Comment alors expliquer cet inégal accès aux apprentissages et quelles réponses apporter ? Quelle place donner à ces élèves qui sortent de la norme ?
Deux voies étaient possibles pour apporter une réponse à ces questions : ou bien l’école telle qu’elle était ne convenait pas à tou·tes et il fallait remettre en cause son fonctionnement, ou bien des enfants y étaient inadaptés. C’est la seconde idée qui va être retenue et un certain nombre de théories vont alors voir le jour pour expliquer cette inadaptation. L’école, dans ses structures, ne sera pas remise en question et ces théories justifieront l’idée selon laquelle des enfants ne pourraient pas être pris en charge par l’école ordinaire, devraient être pris en charge dans des lieux séparés, des lieux spécialisés, voire ne devraient pas être pris en charge du tout. Cette décision est cohérente avec le projet politique du gouvernement de la IIIème République encore “traumatisé” par l’insurrection de Paris et sa courte mais solide République sociale. L’école de la IIIème République se veut vecteur du patriotisme. C’est une période au cours de laquelle se développeront les idées qui infuseront tout le XXème siècle et agissent encore aujourd’hui comme obstacles à la mise en œuvre d’une école vraiment inclusive.
Selon Alexandre Ployé, trois théories vont émerger à la fin du XIXème siècle qui justifieront la mise à l’écart d’enfants en raison de leur prétendue inadaptation naturelle.
La première de ces théories est dite théorie de la dégénérescence héréditaire. Elle est développée à partir du Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l’espèce humaine de Morel publié en 1857. C’est une théorie de la décadence, une forme de darwinisme social, qui explique l’échec scolaire. Elle lie échec et pauvreté dans cette idée qu’en se reproduisant, de générations en générations, les pauvres dégradent en eux-mêmes les qualités morales et intellectuelles innées de l’humanité et n’ont pas les capacités de réussir à l’école. Cette théorie implique aussi qu’il faut séparer le bon grain de l’ivraie, la bonne société des fruits pourris, de manière à endiguer la contagion. Les classes laborieuses sont des classes dangereuses. Il faut protéger la société des plus faibles qui la menacent. Si cette théorie est fortement critiquée dès les années 20, elle trouvera des échos dans les théories eugénistes et dans la théorie du handicap socio-culturel. Cette pratique séparatiste est également à lier aux séparations des filles et des garçons, des « indigènes » et des Français.
Les filles et le système scolaire français : une intégration longue et laborieuse
En 1882, Jules Ferry définit ainsi les missions de l’école sur l’éducation physique et l’éducation professionnelle : « L’école primaire peut et doit faire aux exercices du corps une part suffisante pour préparer et prédisposer en quelque sorte les garçons aux futurs travaux de l’ouvrier et du soldat, les filles aux soins du ménage et aux ouvrages de femme. » À la différence du travail manuel des garçons, basé sur l’acquisition de la dextérité, de la rapidité et préparant au dessin industriel, celui des filles a pour objectif : « (...) de leur faire acquérir les qualités sérieuses de la femme de ménage et de les mettre en garde contre les goûts frivoles ou dangereux ».
Même si les lois Duruy de 1867 et Camille Sée de 1880 imposent la création d’écoles primaires y compris pour les filles dans les communes de plus de cinq-cents habitants pour la première et la création d’un enseignement secondaire pour les jeunes filles, pour la deuxième, les programmes sont différents de ceux des garçons. On prépare les petites filles à devenir de bonnes ménagères avec des manuels de travaux d’aiguille, règles d’hygiène, morale et religion… avec une très légère notion de sciences, littérature et la culture générale afin de leur permettre d’éduquer ou d’accompagner les études de leurs enfants.
Le souci d’économies dans les écoles rurales autorise la mixité mais elle est proscrite lorsque les effectifs le permettent. L’enseignement des garçons et des filles, même dans les mêmes classes, est séparé. L’école de Jules Ferry exclut les filles, s’appuyant notamment sur des théories scientifiques expliquant l’infériorité intellectuelle de la femme ainsi que le risque de dispersion pour les garçons. La “scolarisation” des filles ne sera défendue par les républicains de l’époque que comme enjeu politique dans la lutte anti cléricale.
Après la période révolutionnaire, en 1808 Napoléon interdit aux femmes et aux filles l’accès aux lycées. Le baccalauréat ne sera ouvert aux filles qu’en 1924 et avec lui l’accès à l’enseignement supérieur… sauf que l’autorisation de l’époux sera obligatoire pour une femme souhaitant s’inscrire à l’université jusqu’en 1938.
La théorie suivante relève d’une dimension médicale. C’est à partir de ce moment-là que l’idée du soin se substitue ou se mêle à celle du pédagogique. Désiré Magloire de Bourneville est psychiatre, spécialiste de l’idiotie, l’idiotie étant le nom donné alors au handicap mental. Il propose, pour répondre à la question de l’échec scolaire, de mettre en place le traitement dit médico-psychologique, qui croise des apports médicaux et des apports pédagogiques. Son hypothèse postule l’éducabilité des enfants idiots. Il est le premier à proposer l’ouverture de classes spécialisées dans les écoles ordinaires.
Dans le même temps, Alfred Binet, bien connu pour être le père du test Binet Simon, ancêtre du test du QI qui naîtra quelques années plus tard aux Etats-Unis, développe une idée diamétralement opposée. Si De Bourneville répond aux questions que pose l’échec scolaire par le soin et le traitement, Binet y répond par le tri. Si les élèves n’ont pas les mêmes dispositions pour l’apprentissage, ils ne doivent pas être mélangés. Il faut donc élaborer un outil permettant de diagnostiquer les incapacités, de distinguer ceux que l’on nomme les arriéré•es, les débiles léger•es, les élèves anormales et anormaux. Cet instrument, c’est l’échelle métrique de l’intelligence.
À l’issue de cette première période, une idée maîtresse va donc marquer les esprits jusqu’à aujourd’hui. Que ce soit pour des raisons sociales, médicales ou d’intelligence, il y a des enfants qui n’ont pas leur place à l’école avec les autres, qui y sont inadaptés. Il faut séparer le normal de l’anormal.
On voit bien comment cette idée de l’inadaptation des élèves constitue un des principaux obstacles à la mise en œuvre d’une école vraiment inclusive. Si nous considérons que ce sont les élèves qui sont inadapté•es à l’école, ce n’est pas l’école qui est inadaptée à la diversité des élèves. Il n’y a donc aucune raison de la changer.
L’école de Jules Ferry : colonialiste et raciste
La Troisième République introduit en Algérie le “modèle” de l’école gratuite, obligatoire et laïque mais sépare bien les enfants indigènes des européen·nes. Des exceptions sont faites pour quelques fils de notables indigènes algériens.
Avant les lois Ferry (de 1881 et 1892), l’instruction des indigènes ne figure pas au programme colonial. Jules Ferry considère que l’école pour les indigènes est le “moyen le plus efficace pour asseoir la domination territoriale de la France et pénétrer les âmes conquises” sa phrase du 28 juillet 1885, “les races supérieures ont un droit sur les races inférieures”, en sera le cadre.
Les « écoles spéciales aux indigènes » seront animées par des moniteurs indigènes et des instituteurs indigènes et français. Les enseignant·es n’ont pas le même salaire ni la même formation selon si ils ou elles sont indigènes ou européen·nes : c’est le système d’enseignement colonial.
A travers cet extrait du Plan d’études et programmes de l’enseignement primaire des indigènes en Algérie publié en octobre 1890, les fondements de la pensée coloniale et raciste portés par Jules Ferry apparaissent sans équivoque.
Dans sa Note Préliminaire le recteur d’Alger Charles Jeanmaire explique :
“Il est certain que des instituteurs français pourraient les trouver un peu monotones, un peu naïves. Mais qu’on veuille bien remarquer qu’elles sont faites pour guider des maîtres indigènes, qui ne sont que de simples moniteurs, dont l’aptitude est aussi modeste, en général, que le titre, mais que nous sommes pourtant bien obligés d’employer, parce que seuls, ils consentent à aller enseigner les éléments de la langue française à leurs jeunes coreligionnaires,sur les points les plus reculés des douars ou des tribus, dans des endroits où jamais ne se résignerait à vivre un instituteur français, même avec un traitement élevé. Alger, le 15 octobre 1890. Le Recteur, C. JEANMAIRE"
Le rapporteur de la commission ayant élaborée le dit plan, Monsieur Lacabe écrit : “la Commission n’a pas oublié, dans la rédaction qu’elle a adoptée, que, d’une part, les programmes s’adressent à des élèves étrangers à la langue et aux idées françaises, et que, d’autre part, l’application en sera confiée presque toujours à des moniteurs indigènes. Ces deux considérations lui imposaient d’un côté des visées très modestes, afin de rester dans les limites de ce qui est réalisable, (...) Les maîtres y trouveront tout ce qu’on peut raisonnablement enseigner à des Arabes ou des Kabyles dans une première année d’études primaires, mais ils ne devront pas chercher à dépasser le cadre qui leur est tracé.
(...) La France confie aux moniteurs indigènes une mission noble entre toutes : celle d’élever leurs frères, de les initier à la plus belle et à la plus riche langue du monde. Elle les charge d’ouvrir leur intelligence à ces merveilleuses inventions qui font notre puissance, leur cœur aux sentiments de bonté, de générosité qui ont toujours animé le peuple français. Elle les fait participer enfin à l’oeuvre de régénération qu’elle a entreprise en Algérie. (...) Faire pénétrer auprès de leurs coreligionnaires les lumières et les bienfaits de la civilisation : n’est-ce pas là une tâche digne de tenter leur orgueil? (...) Daignez agréer, Monsieur le Recteur, l’hommage de mon dévouement très respectueux. Le Rapporteur, LACABE".
Le développement de l’enseignement spécialisé
Entre 1905 et 1909, la commission Bourgeois, en application de la loi de 1882 sur l’instruction primaire obligatoire, travaille sur la question de la scolarisation des enfants dits « arriérés ». Le travail de cette commission est à l’origine de la loi de 1909 sur les classes et écoles de perfectionnement pour les enfants arriérés.
Pour illustrer ce mouvement, Alexandre Ployé cite Alfred Binet qui, dans son ouvrage Les idées modernes sur les enfants publié en 1909, écrit :
« Rien n’est plus intéressant que de connaître la psychologie de ces cancres ; il faut les examiner l’un après l’autre, savoir pour quelle raison ils occupent ce rang inférieur, si c’est par défaut d’intelligence ou de caractère, et si leur état peut être amendé. C’est une question qui a une grande importance sociale ; et on doit se préoccuper constamment de diminuer le nombre de ces déchets, afin qu’ils ne deviennent pas définitifs. »
Deux idées principales sont à retenir :
1- les enfants en échec sont des déchets pour la société et il convient de s’en protéger comme on se protège d’une maladie ;
2- il y a peut-être une possibilité d’amender cet état de fait.
De l’entrelacement de ces deux idées naissent les classes de perfectionnement, des classes séparées pour parfaire des enfants imparfaits. Des pédagogies spéciales, des méthodes dédiées – en extérieur, par le travail manuel... - permettront de réparer ces enfants, de rattraper peut-être leur « retard mental », de compenser le retard de développement.
Pour ces enfants qui sortent de la norme scolaire, le système éducatif se divise alors en deux voies et ce pour tout le XXème siècle : la voie spécialisée dans l’école (classes de perfectionnement, section d’enseignement spéciales, CLIS, SEGPA, ...) pour les enfants « débiles » et « caractériels » et les sections spéciales en dehors de l’école, au sein des hôpitaux psychiatriques ou des établissements médico-pédagogiques pour ceux que le ministère appelle alors les « malades mentaux et les arriérés profonds ».
Rappel de quelques repères du XXème siècle :
1909 : création des classes de perfectionnement. C’est une forme de progrès car les enfants sont à l’école, mais encore exclu·es au sein même de l’école. Ce dispositif perdure jusque dans les années 1990. On parle alors de réadaptation, de réparation d’un point de vue éducatif et pédagogique. Le maître mot est la spécialisation concernant la prise en charge des personnes en situation de handicap.
Après la 2nde guerre mondiale : création d’institutions spécialisées (IME, IMP…) en lien avec la création de la Sécurité Sociale.
1963 : création du CAEI (certificat d’aptitude à l’enfance inadaptée).
A partir des années 70, la logique de prise en charge du handicap est celle de l’intégration (champ du handicap) et de l’adaptation (champ de la grande difficulté scolaire).
1970 : création des GAPP (groupe d’aides psycho-pédagogique), dans un courant d’adaptation et de prévention.
1975 : on parle de handicap à l’école. Première loi en faveur des personnes handicapées pour qu’elles soient « intégrées » à la société. On y inscrit l’obligation d’éducation. On crée donc des postes d’enseignants dans les établissements spécialisés.
1991 : création des CLIS et SEGPA, UPI (pour les lycées).
Il apparaît clairement que cette structure est solide comme sont solides nos représentations de ce que doit être un élève et de ce que doivent être nos métiers. Ces représentations constituent de véritables obstacles à la mise en œuvre d’une école réellement inclusive.
Le défi d’une école vraiment inclusive
En France, une série de lois est promulguée à partir de 2005 qui entend transformer les regards portés sur le handicap dans la société et dans l’école et changer les structures et les pratiques.
- La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cette loi est considérée comme fondatrice en ce qu’elle intègre au droit commun des spécificités pour les personnes handicapées, comme l’obligation de scolarisation. Il y a une logique de compensation du handicap.
- Arrêté du 2 avril 2009 concernant la création des unités d’enseignements dans les établissements médico-sociaux.
- La loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République : la loi sur la Refondation de l’école consacre pour la première fois le principe d’inclusion scolaire.
- la circulaire du 21 août 2015 relative aux unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis).
- La loi du 26 juillet 2019, pour une école de la confiance : affirmation d’une école inclusive. Cette loi crée un service public de l’École inclusive qui vise à replacer la proximité et la réactivité au cœur de l’organisation de l’accompagnement des élèves en situation de handicap, ainsi qu’à simplifier les démarches des familles et personnaliser les parcours des élèves.
Il faut également envisager ce mouvement vers une école et une société inclusives dans un cadre européen et international, depuis la Déclaration de Salamanque de 1994, et au travers de la Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006 de l’organisation des Nations Unies.
C’est désormais à l’école de s’adapter à la diversité, de faire place à « l‘infinité de singularités qui constitue l’humanité » pour reprendre l’expression de Charles Gardou. L’école doit être à tous et toutes et pour tous et toutes . La centration sur le handicap s’est déplacée vers la prise en compte des élèves dits « à besoins éducatifs particuliers », c’est à dire que l’attention s’est élargie à un public d’élèves présentant un écart à la norme scolaire : élèves en difficulté, avec des troubles « dys », HPI… Concernant les classes hier encore spécialisées au sein des écoles, le changement de paradigme est déclaré : la classe de référence constitue désormais le système principal de scolarisation et les dispositifs doivent désormais s’envisager comme des soutiens à cette scolarisation.
Cependant, il ne suffit pas de décréter l’école inclusive pour qu’elle soit pleinement mise en œuvre.
En effet :
- Malgré l’invocation d’une école inclusive par les gouvernant•es, cette tripartition classe ordinaire – classes spécialisées – établissements médico-éducatifs, demeure.
- La France essaie de maintenir jusqu’ici l’existence des IME et des ITEP ; c’est une spécificité française que même la loi de 2005 n’aura pas réussi à gommer. Pour rappel, en 2018, on comptait 2168 établissements médico-sociaux et 1740 SESSAD (source DREES). D’après le MEN, en 2018-2019, plus de 80000 élèves sont scolarisé•es en EMS ou hôpitaux, sur une population accueillie d’enfants et de jeunes s’élevant à environ 105000.
- Le recours à la médecine pour trier et orienter les élèves demeure puissant et très peu remis en question ;
- L’inclusion dans les établissements scolaires d’un élève en situation de handicap est encore trop souvent soumise à la présence d’un•e accompagnant•e dont on connaît la précarité du statut qui demeure depuis bientôt 20 ans !
- Beaucoup (plusieurs milliers mais aucun chiffre officiel précis) de jeunes restent aujourd’hui non scolarisé·es et/ou n’ont pas d’accès à l’école. Certain·es sont à la maison, soit par absence de solution, soit par soumission à la logique de “tri” qui s’opère désormais à l’entrée des établissements spécialisés du fait du manque de moyens et de places
- Nous observons depuis plus de 15 ans des publications de textes officiels (circulaires, arrêtés, lois…) de plus en plus marqués d’une volonté inclusive forte, à l’école comme dans la société en général. Mais dans le même temps, nous constatons une école figée dans une organisation systémique qui continue d’exclure, de stigmatiser, de trier les élèves : les programmes, les constitutions de classe, les effectifs, les manques de formation des enseignant·es, les évaluations des élèves (diplômantes ou non), les logiques d’orientations subies, les manques de moyens… Les injonctions paradoxales persistent malgré les avancées notables en termes de droits pour les élèves et leurs familles.
Pour opérer le tournant vraiment inclusif, une transformation des représentations et un changement des pratiques sont nécessaires. Ces changements ne peuvent cependant pas reposer sur la seule bonne volonté de ceux et celles qui travaillent à l’école. Nous avons besoin de moyens et de formation. En ne développant qu’un discours injonctif, la hiérarchie provoque des réactions de rejet d’une partie de nos collègues qui retrouve dans la longue histoire séparatiste de l’école et du handicap en France un sentiment de sécurité.
Nous sommes un syndicat de transformation sociale, nous nous opposons à toutes les formes de discriminations et de ségrégations, nous nous battrons aux côtés des collectifs antivalidistes et des travailleurs et travailleuses de l’éducation, du médico social pour qu’une école vraiment inclusive voit le jour, une école débarrassée de ses préjugés normatifs, une école émancipatrice pour tous et toutes.
Depuis la loi de 2005, quel changement ?
15 ans après, le compte n’y est toujours pas.
La loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et plus particulièrement son article 19 concernant l’école, avançait de grandes promesses quant à la scolarisation des enfants en situation de handicap.
Avant 2005, bien que le droit à la scolarité pour tous les enfants soit confirmé en 2000 par la création du Code de l’éducation, c’était aux enfants de s’adapter à l’école qui leur faisait une place à la condition qu’ils et elles puissent se conformer sans compensation à ses normes et exigences. Face à l’impossibilité de s’y plier, ils et elles sont alors pour la plupart relégué·es vers l’éducation spécialisée, les établissements médico-sociaux ou encore la scolarisation à domicile. La loi de 2005 annonçait, du moins sur le papier, une volonté de renverser totalement cette façon de penser. Ce sera désormais à l’école la plus proche du domicile de l’enfant de s’adapter, de se donner les moyens de l’accueillir et surtout de répondre à ses besoins particuliers.
Le droit à la scolarité en milieu ordinaire, si tant est qu’il est prescrit par les toutes nouvelles MDPH, doit donc être garanti par l’État pour tous les enfants et non plus seulement pour ceux dont les parents ont l’énergie et les ressources sociales et financières pour forcer les portes des écoles et y faire entrer leurs enfants.
Un bilan positif pour les communicant•es du ministère
Lorsqu’il s’agit du handicap, il y a les chiffres fournis par le ministère de l’Éducation nationale qui permettent une illusion de bilan positif et il y a la cruelle réalité dans nos écoles et établissements scolaires : un manque crucial d’accompagnement des élèves, de formation des élèves et d’adaptation des bâtiments scolaires. Ils nous montrent que le nombre d’élèves accueilli•es en milieu scolaire ordinaire passe de 118000 en 2005 à 400000 en 2021. Une augmentation certes significative mais qui ne tient pas tant des politiques volontaristes des gouvernements que du fait que le droit à la scolarité en milieu ordinaire est une obligation inscrite dans la loi pour toutes et tous et que les parents ne manquent pas, à juste titre, de faire valoir les droits de leurs enfants. De plus, certaines formes jusqu’ici ignorées (handicap psychique, troubles « dys », troubles de l’attention etc.) sont désormais reconnues comme situations de handicap, faisant augmenter mécaniquement le nombre de dossiers en MDPH.
Le nombre de personnels AESH est passé de 25000 à 129000 avec la création de 4000 postes à la rentrée de 2022. Là encore, une augmentation importante, que les chargé.es de communication du ministère ne se privent pas de mettre en avant, mais qui est encore et surtout une conséquence de l’application de la loi de 2005. Cette loi institue la notion de « compensation » du handicap que doit garantir l’État afin de répondre aux besoins particuliers des enfants et qui consacre l’obligation qui lui est faite de mettre en œuvre les moyens humains et financiers nécessaires. À l’école, cette compensation se traduit majoritairement par l’accompagnement des élèves. Chaque ministre depuis 2005 y est allé de sa petite séance d’auto-congratulation, de sa petite révolution de l’inclusion, de son petit slogan. Mais sur le terrain, au bout de quinze ans, il n’y a pas vraiment de quoi se vanter. Les mauvaises conditions de travail, l’absence de statut, les bas salaires et le manque de reconnaissance, nuisent à l’attractivité du métier.
Mutualisation et PIAL : les économies budgétaires valent plus que les droits des élèves
Enfin, la circulaire d’emploi de 2019 généralise la mutualisation de l’accompagnement dans les PIAL (pôle inclusif d’accompagnement localisé).
Créée en 2012, cette mutualisation visait à pallier l’augmentation massive de la scolarisation d’enfants handicapé•es en milieu ordinaire et des prescriptions d’accompagnement. Les moyens n’évoluant pas en fonction des besoins, la possibilité de mutualiser les moyens est désormais prévue par la loi. La mutualisation nécessite que le nombre d’heures hebdomadaires d’accompagnement attribuées aux enfants ne soit plus précisé par la MDPH: il y a davantage d’élèves accompagné•es mais chaque élève bénéficie de moins d’heures. Plus il y a d’élèves en situation de handicap dans un PIAL, moins chacun·e de ces élèves sera accompagné·e. La charge de déterminer les heures nécessaires et de les répartir revient donc à l’Éducation nationale en fonction des moyens humains à disposition et non des besoins des élèves.
Mais pour la Cour des comptes ce n’est pas encore assez. Dans un rapport publié en mars 2018, elle donne comme injonction au ministère de reprendre la main sur les prescriptions MDPH en incitant les commissions d’attribution, où siège un·e représentant·e de la DSDEN, à notifier massivement des aides mutualisées et non des aides individuelles.
Or, cette mutualisation pose de nombreux problèmes sur la qualité de l’accompagnement. Le ministère et les rectorats font les choses à l’envers : ils déterminent un nombre de postes d’AESH, ces postes sont ensuite répartis entre les élèves. Dans l’intérêt des élèves, et dans l’esprit de la loi de 2005, la logique devrait être inversée. Les besoins d’accompagnement des élèves devraient d’abord être évalué•es puis les postes devraient être créés en fonction des besoins. Mais cela génère le risque d’une augmentation des coûts salariaux peu compatible avec la gestion comptable qui prévaut au ministère. Ensuite, du fait de l’obstination du ministère à maintenir des contrats à temps incomplet, les AESH partagent leurs peu d’heures entre 3 voire 4 élèves. Les élèves se retrouvent alors avec 4h d’accompagnement par semaine. Il s’agit là d’un réel mépris des besoins des enfants mais aussi du rôle et de l’importance de l’accompagnement fourni par les AESH au quotidien. Les emplois du temps sont construits à l’emporte-pièce, façon puzzle, les AESH sont contraint·es d’aller d’un·e élève à l’autre sans tenir compte de la pertinence pédagogique de l’accompagnement. Ainsi un·e élève dyslexique peut se retrouver sans aucun accompagnement en cours de français.
Le développement des PIAL, qui répond parfaitement aux attentes budgétaires de la Cour des comptes, renforce lourdement cette tendance à l’augmentation du nombre d’élèves suivi par un·e AESH.
À l’arrivée, un bilan scandaleux pour les élèves
Les grèves des AESH menées depuis 2021, les mobilisations de l’ensemble de la communauté éducative comme par exemple la grève des écoles de Saint Herblain (44) en décembre 2021, montrent que derrière la propagande ministérielle, la réalité de l’école inclusive est consternante : scolarisation inadaptée, à temps incomplet faute d’accompagnement à la hauteur des besoins, voire absence totale de scolarisation...
Depuis 5 ans des associations mènent des enquêtes à chaque rentrée auprès des familles. Elles estiment que, chaque année, ce sont 10 à 12 % d’enfants ayant une notification qui font leur rentrée sans AESH. 5 à 6 % d’entre eux et elles passeront toute l’année sans AESH, les privant complètement pour beaucoup de leur droit à la scolarité. Dans son rapport de 2021, la Médiatrice de l’Éducation nationale préconise de « [recentrer] la conception de l’accompagnement de l’enfant sur la continuité de son parcours et non sur les moyens disponibles » et « d’éviter le morcellement des services des AESH en privilégiant un emploi du temps concentré sur une même aire géographique, voire un même établissement », c’est-à-dire d’abandonner le PIAL.
Penser l’inclusion c’est repenser l’école
Pour le chercheur Alexandre Ployé, « les pays qui font figure de modèle ne se sont pas contentés d’amender le système scolaire à la marge. Ils l’ont revu de fond en comble. Ils ont remis en cause les programmes, les normes scolaires habituelles… Tant que l’on restera dans notre logique actuelle d’évaluation et d’orientation, de nombreux enfants en situation de handicap ne trouveront pas réellement leur place à l’école. Ils seront dedans et dehors à la fois. L’inclusion scolaire reste aujourd’hui un processus inachevé. »
Il faut souligner que l’accès à l’école c’est l’accès à la socialisation, aucun enfant ne doit en être privé. Le handicap, comme la difficulté scolaire ou sociale ne doivent plus être des prétextes pour exclure les enfants des classes ou des écoles. Que signifie un droit réel à l’école pour tou·tes, et comment aider les enseignant·es - qui pour l’immense majorité, souscrivent aux principes de la loi de 2005- à ne pas porter seul·es des situations parfois extrêmement complexes ?
Nombre d’élèves en situation de handicap ont des besoins qui ne sont pas seulement scolaires et, de ce fait, le travail pluridisciplinaire et l’appui des dispositifs spécialisés est plus que nécessaire. Aujourd’hui, le manque de moyens et de personnels médico-sociaux, comme le trop grand nombre d’élèves par classe, génèrent une souffrance qui incite certain·es collègues à envisager la scolarisation de certain·es enfants handicapé·es comme une dégradation supplémentaire de leurs conditions de travail. De même, les conditions actuelles d’inclusion génèrent parfois de la souffrance pour les élèves.
Bien au-delà du handicap, l’école inclusive est le moyen de repenser l’école dans le sens d’une école démocratique c’est-à-dire une école de l’égalité des droits, une école où personne n’a à faire la preuve de sa capacité à être là. Pendant longtemps, ces élèves différent•es ont été « scolarisé•es » ou accueilli•es entre eux et elles dans des structures différentes sans que personne ne puisse jamais faire la démonstration que c’était mieux pour eux et elles, même si cette ségrégation scolaire menait nécessairement à une ségrégation sociale des personnes handicapées.
L’école inclusive n’est pas la négation du handicap, elle est plutôt la reconnaissance d’une communauté de tou·tes les élèves qu’importe le handicap. À nous, personnels de l’éducation, de nous battre avec les personnes handicapées, avec les familles de nos élèves pour gagner les moyens d’une école vraiment inclusive, ouverte et capable d’accueillir tou·tes les élèves.
Quelles revendications pour les personnes handicapées à l’école ?
En juin 2022, le CLHEE (Collectif Lutte et Handicaps pour l’égalité et l’émancipation) a participé à un stage de SUD éducation à destination des personnels AESH en Île-de-France. Nous, syndicalistes SUD éducation, avons voulu aller plus loin dans l’échange et un de nos camarades a pu interviewer Elena, Cécile et Leny afin de mieux connaître leur combat antivalidiste, de nourrir le débat et notre pratique syndicale par les revendications des personnes handicapées elles-mêmes.
SUD éducation : pouvez-vous présenter votre collectif ?
Elena Chamorro : le collectif a été créé en avril 2016. En 2013, on a créé un autre collectif, auquel appartenait la plupart des membres fondateurs du CLHEE, et qui s’appelait « Non au report de 2015 ». On s’est prononcé contre le report du volet accessibilité de la loi de 2005 parce que l’État n’avait pas respecté le délai de 10 ans qu’avait prévu la loi de 2005 pour la mise en accessibilité des équipements et des établissements recevant du public. Donc, tout a commencé comme ça. On a commencé aussi notre critique du rôle des associations gestionnaires, et leur responsabilité dans nos « malheurs », on va dire, et du coup on a cheminé dans une réflexion qui nous a amenés à nous dire qu’il y avait un vide dans le militantisme français, dans l’antivalidisme. Donc, voilà, il y a eu un cheminement dans la prise de conscience et vers la décision de créer ce collectif, dont le but était, d’une part, de dénoncer le rôle des associations gestionnaires mais aussi de militer pour la désinstitutionnalisation, de défendre des représentations justes de nous-mêmes, de défendre la Convention Internationale des droits des personnes handicapées. On s’inscrit dans ce militantisme des droits humains.
Leny Marques : on est un collectif de personnes concernées qui essaie de s’attaquer à plus gros que l’accessibilité dans la lutte pour les droits des personnes handicapées.
Du point de vue du langage, on peut entendre « personne en situation de handicap », j’ai entendu des militant•es revendiquer l’expression « personne handicapée ». Y-a-t-il un vocable qui a votre préférence ?
Cécile Morin : personne en situation de handicap, ça nous convient, personne handicapée, ça nous convient aussi dans la mesure où on n’en fait pas un substantif, où on ne dit pas « les handicapé•es », où, là, ça ne nous convient plus. Après, la notion de handicap ne nous satisfait pas spécialement, seulement il faut quand même à un moment prendre un langage commun pour se faire comprendre, donc on se désigne comme personnes handicapées, ou comme personnes directement concernées par le handicap.
Leny Marques : moi, j’ai une petite préférence pour personne handicapée, parce que la situation, le problème c’est qu’en effet, ce n’est pas que le handicap ne constitue pas l’entièreté de notre personne mais réduire ça exclusivement à une situation c’est un peu limitant dans le sens où il y a aussi une partie de notre identité qui est constitutive de notre situation.
Elena Chamorro : au-delà de ça, moi, je pense que l’expression en situation de handicap qui était en effet une appellation qui correspondait au modèle social du handicap, c’est-à-dire qui pointait l’environnement comme responsable du handicap, a été un petit peu récupérée par l’ennemi, on va dire. C’est devenu du politiquement correct et, en plus, ça ne désigne plus la situation mais renvoie quelque part au modèle médical, parce que quand on dit « personne en situation de handicap mental », on n’est pas en train de désigner la situation qui crée le handicap mais la déficience quelque part. [...] Moi je dis toujours que je suis une personne handicapée, presque il faudrait dire handicapisée, c’est-à-dire handicapée au sens passif du terme ; on est handicapé•e parce que la société nous handicape, ce qui n’empêche pas l’identité handicapée, entendue comme une manière particulière d’être au monde peut être, mais je veux dire qu’il faut comprendre « handicapé•e » comme les racisé•es entendent le terme racisé•e.
Depuis la loi de 2005, les lois de 2013 dite d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République et de 2019 dite pour une école de la confiance prétendent construire l’école inclusive. Comment vous positionnez-vous dans cette histoire et cette actualité ?
Cécile Morin : il y a deux choses. C’est d’abord sur le terme école inclusive. École inclusive, c’est une façon de remettre en cause la légitimité des élèves handicapés à avoir accès à l’école puisque, vous voyez, on va rajouter, en fait, une catégorie pour bien monter que là encore on est dans la rhétorique de l’effort, l’école va faire un effort pour inclure des élèves qui avec ce terme sont supposé•es n’être pas tout à fait légitimes pour y être. C’est l’école qui va les inclure. Donc le fait d’inventer un adjectif remet en question en réalité la légitimité de ces élèves à y être parce que, si on fait la même chose avec d’autres catégories d’élèves, on ne va pas parler par exemple d’école inclusive pour les filles, simplement parce que, aujourd’hui, quand même, on considère que l’égalité de l’accès à l’école, c’est pour les filles et pour les garçons. Donc, déjà, nous, cet adjectif, qui va devenir une épithète déclinée là aussi en machin truc inclusif, pour nous, remet en cause la légitimité de ces élèves à avoir juste l’égalité des droits, c’est-à-dire l’accès à l’école. Ensuite, notre combat politique c’est la désinstitutionnalisation, c’est-à-dire la fin de ce qui est considéré par le droit international, et Elena en a un petit peu parlé en citant la référence à la Convention des droits des personnes handicapées des Nations Unies, ce qui est considéré par le droit international comme de la ségrégation, c’est à dire l’assignation des personnes handicapées, des enfants puis ensuite des adultes à des lieux où elles et ils sont mis à l’écart de la société et n’ont pas l’égalité des droits et c’est le cas pour les élèves qui sont placés par exemple dans des établissements médico-sociaux où la durée de scolarisation est souvent très faible : moins d’une demi-journée par semaine pour plus d’un tiers des enfants handicapé•es d’après un rapport parlementaire de 20191. Donc, voilà, nous, on est absolument contre cela. Forcément le fait que des élèves qui, il y a quinze ans auraient été placés d’emblée dans des institutions spécialisées, soient scolarisés à l’école ordinaire, évidemment, on pense que c’est juste l’application de l’égalité des droits. Seulement dans l’éducation nationale, la politique de Blanquer a consisté à appliquer cela de la façon la plus mauvaise possible, c’est-à-dire sans affecter des moyens à hauteur des besoins individuels des élèves. C’est à dire qu’il n’y a à la fois pas assez d’AESH, mais que dans les pays où la désinstitutionnalisation s’est faite à l’école, les adultes qui accompagnent les élèves sont aussi des enseignant•es spécialisé•es qui sont dans les classes. En plus, évidemment, le fait que les moyens soient très insuffisants, ça produit un effet très pervers qui est de braquer une partie de la communauté enseignante contre le fait que ces élèves soient inclu•es à l’école ordinaire en disant, voilà, « l’école ne leur convient pas », et « ils seraient mieux ailleurs ». Nous on veut que les élèves handicapé•es soient scolarisé•es, aient accès à l’école comme les autres, avec les moyens qui sont nécessaires à leurs besoins et ce sont des moyens pas seulement d’accompagnement humains mais des moyens aussi d’accompagnement éducatif en fait.
L’histoire française de l’école et des handicaps est marquée par une tendance séparatiste. La première revendication de votre manifeste concerne la lutte pour la désinstitutionnalisation. Pouvez-vous présenter ce combat, préciser ses origines, ses modalités et ses perspectives ?
Cécile Morin : c’est très important ça parce que tant qu’il y aura des IME qui existeront, qui continueront à exister, on pourra toujours dire, « ils seraient mieux ailleurs ». Quelque chose qui nous semble extrêmement important aussi et que les enseignant•es savent mal, c’est que l’orientation en IME, c’est la mort sociale. C’est à dire qu’il y a un effet de filière, quand on dit « l’IME » « c’est de plus petits effectifs », etc, il faut quand même voir le destin social des élèves. Qu’est ce qu’ils deviennent après l’IME ? Et bien, ce qu’ils deviennent après l’IME, c’est qu’ils vont d’une institution à une autre et ils passent toute leur vie dans des institutions. L’institutionnalisation, ça veut dire qu’on est privé de droits, à commencer par le droit de choisir avec qui on veut vivre. Ça veut dire que ça exacerbe toutes les violences. Il faut comprendre cela, parce qu’en fait, ce sont des lieux fermés, où il n’y a pas de contrôle extérieur et où les individus, une fois qu’ils deviennent adultes, par exemple, vivent toute leur vie avec les 30 mêmes personnes. Ça veut dire, par exemple, qu’après une séparation amoureuse, il n’y a pas de séparation physique. Donc ce sont vraiment des lieux où les violences, notamment les violences faites aux femmes, sont très importantes d’après les statistiques qu’on peut avoir, qui sont lacunaires etc, mais ce qui se comprend bien parce qu’il n’y a pas de contrôle extérieur et parce qu’on n’entend pas ces gens, ces enfants ou ces adultes. Tous les échos qu’on a, ça passe par le personnel médico-social avec des lanceurs d’alerte dans ces établissements. Quand on dit « ils et elles sont privé•es de droits », ils et elles sont privés•e du droit par exemple à la parole. Même dans les articles de journaux, on n’interviewe jamais, et jamais seuls, en dehors de la présence de l’encadrement, les gens qui sont institutionnalisés. Ils et elles n’ont jamais le droit à la parole, et de toutes manières, n’ont pas de droits. Du coup, il faut bien voir cela, il faut bien voir que, et pour ça aussi on pourra vous envoyer des statistiques, par exemple l’orientation des élèves dans des institutions spécialisées dépend avant tout du milieu social des parents. C’est-à-dire qu’il y a une très grande injustice sociale dans le destin scolaire des élèves handicapés , c’est à dire que les parents les mieux informées sur cet effet de filière parviennent mieux à maintenir leurs enfants à l’école ordinaire. Ça se fait vraiment au capital social et culturel. Les gens qui savent ce que c’est qu’un IME, comment ça se passe et surtout ce qu’on devient une fois qu’on a mis les pieds là dedans, comment il est difficile d’en sortir, l’évitent pour leurs enfants s’ils ont la possibilité sociale de le faire. Ça, vraiment, il y a une injustice sociale très très grande là-dedans et il faut savoir que l’orientation en IME, c’est la mort sociale.
Elena Chamorro : pour poursuivre ce que dit Cécile, pour le cas des enfants dyspraxiques par exemple, ce qui leur est proposé, en gros, c’est ce petit PAP, dont on c’est ce que c’est : un vœu pieux ; dans le meilleur des cas, avec une grosse bataille, parfois juridique des parents peut-être, une reconnaissance MDPH et une AESH mutualisée qui est là pour un accompagnement de cinq heures, en gros. Ce que l’école fait, c’est un peu comme ce qui se passe maintenant avec la pandémie. Il n’y a pas de gestion collective qui inclut ces élèves, c’est à la personne concernée que l’on considère ne pas être dans le moule de rechercher les solutions pour rentrer dans le moule, et elle doit les chercher en dehors de l’école. Et les solutions, c’est des rééducations payantes, des neuro- psychologues, des orthophonistes…. C’est à dire on va ailleurs, on essaie d’être au niveau des exigences de l’école qui de toutes façons ne bougera pas, il n’y aura pas une pédagogie qui se diversifiera, il n’y aura pas un•e enseignant•e qui sera formé, en tous cas, c’est l’état actuel, mais on dira à l’enfant handi d’aller voir une orthophoniste etc, et celles et ceux, nombreuses et nombreux, non reconnu•es handis par les MDPH iront, si leurs parents ont les moyens, voir une psychomotricienne etc, et de toutes façons, il y a peu de chance qu’ils et elles arrivent à devenir comme celles et ceux pour qui l’école est faite. C’est une école du tri, et, dans ce tri-là, même les gamin•es les mieux accompagné•es sont quand même en inégalité de chances.
Cécile Morin : c’est le milieu social qui est déterminant. On a une pathologisation des problèmes sociaux par le biais du handicap. Ça, ce n’est pas nouveau, le handicap a servi à pathologiser les formes d’exclusion sociales et ça on le voit très bien par l’orientation des élèves par exemple en SEGPA, qui est faite comme ça parce que les parents ne peuvent pas vraiment se défendre.
L’école française est-elle validiste ? De quelle manière ? Quelles sont les discriminations et les relégations communément vécues par les élèves handicapés dans le système scolaire ?
Cécile Morin : je pense que sur cette question, il y a deux choses. Il y a tout ce dont on a parlé, c’est à dire le traitement et l’orientation des élèves et la façon dont ils sont déconsidérés, ok, mais ensuite, il y a le discours des enseignements disciplinaires sur le handicap dont parlait Elena. Or, dans les ressources sur le handicap proposées aux enseignants, y compris parmi celles validées par les IPR sur les sites académiques ou sur Eduscol, on trouve beaucoup de représentations validistes. Déjà, il n’y a pas du tout de sensibilisation au validisme, le validisme n’existe pas, ne semble pas exister, alors que, par exemple, en matière d’égalité filles/garçons, il y a eu des associations, je pense à une association comme Mnémosyne, qui a produit énormément de ressources qui ont infusées dans l’éducation nationale, et il y en a qu’on retrouve, donc, là, il y a eu vraiment des choses de faites mais, là, un•e enseignant•e de bonne volonté qui ne connaît pas grand-chose, elle ou il va diffuser un discours validiste en fait, en toute bonne foi…
Lény Marques : et en plus, ça n’existe pas en dehors des cours spécifiques. C’est-à-dire qu’en histoire, il n’y a pas une seule ligne sur notre histoire.
Cécile Morin : alors là, je renvoie à un article que j’ai écrit sur le handicap dans l’enseignement, de l’histoire notamment2.
Lény Marques : et ça, c’est un peu le cas dans l’histoire de plein de groupes discriminés, c’est-à-dire qu’on est invisibles dans toutes les autres matières, par contre on existe que dans le validisme, il n’y a pas de réflexion propre aux personnes handicapées avec un discours claire sur l’exclusion, non. En même temps, l’institution ne va pas se tirer elle-même dans les pattes, c’est bien connu.
Elena Chamorro : on a juste, par rapport à ce que disait Cécile, on n’a pas beaucoup de ressources particulières, mais on a cet article de Cécile3, j’ai aussi analysé un petit peu une vidéo faite par Les petits citoyens4, qui était une espèce de vidéo à utiliser à destination des enseignants pour faire des sensibilisations au handicap, et après, j’avais fait un petit texte aussi sur les mises en situation5 qui pourra aussi peut être vous éclairer sur les démarches complètement à côté de la plaque, qui ont cours. Et après, moi je sais qu’en espagnol, les professeur•es ont recours à toutes les productions culturelles, films, etc, qui se font, et qui sont encore dans ces carcans de vision très validistes : on est soit misérable, soit des êtres extraordinaires, voilà … Il y a tout ça. Il y a très peu de ressources qui soient produites par les personnes concernées elles-mêmes. Et là, je vous disais, il y a une petite perle, parce que c’est une perle rare, c’est pas magnifique comme série, mais c’est à relever. Je parle de la série Un mètre vingt6, qui est une série à recommander à tous les lycéen•nes parce que c’est écrit par une personne concernée, elle le joue elle-même, c’est un point de vue situé, ce qui n’est souvent pas le cas. C’est pas un regard posé et un regard surplombant qui explique les autres à celles et ceux qui sont comme moi.
Cécile Morin : les dévalideuses et le CLHEE ont produit des ressources aussi, par exemple, je pense à une vidéo pour France TV slash, faite à leur demande, sur le validisme7. Donc, tu vois, c’est un petit spot, il y a un petit travail de montage, c’est à destination d’un public lycéen. On a produit aussi et mis en ligne des ressources comme le texte d’Elena etc. ça, maintenant, bon… On va continuer mais…
Elena Chamorro : il y a juste un truc, on a parlé beaucoup de la partie des moyens, des manques de moyens, et on a dit aussi, on a pointé que le grand problème était l’existence de l’école spécialisée qui autorise des discours de la part des profs, voilà… de certain•es profs qui résistent et qui se plaignent, à juste titre, des manques de moyens mais qui ne pointent pas le problème réel, qui voudraient se débarrasser des enfants, c’est à dire qu’ils trouvent qu’ils ne sont pas légitimes à l’école. Une phrase qui revient souvent c’est « j’en ai 30, donc je ne peux pas. » Donc, ces 30 sont légitimes et l’autre a un besoin particulier auquel je ne peux pas répondre. Et il n’y a à aucun moment dire, ben, moi, ce 31, il est dans la masse, et moi, je dois répondre à l’ensemble. Ça c’est le grand truc à faire comprendre, peut- être. Et alors, tu demandais quelles sont les discriminations, les relégations communément vécues, il y a un hashtag qui a circulé il y a quelques mois, qui s’appelait #nouseleveshandi et après, il y a eu #nousetudiantshandi8 et là tu pourras, si tu cherches des anecdotes et des petits témoignages qui, en fait, par leur nombre font système, et on voit qu’il ne s’agit pas de petit•es profs isolé•es dans leurs coins, mais que c’est vraiment un système qui produit ça, et voilà, ça vaut le coup de dire ce que l’on vit au quotidien.
Cécile Morin : il y a juste un truc dont on n’a pas parlé, c’est la politique en direction des élèves handicapés, l’Education nationale les oriente vers le professionnel aussi. Ça, c’est un truc vraiment important. Les ULIS par exemple, il n’y en a que dans les lycées pros et technologiques, pas dans les lycées généraux. Pourquoi ? Parce que les élèves handicapé•es, quel que soit leur handicap, sont orienté•es vers la voie professionnelle, mais en dépit du bon sens et souvent, de ce qui leur plaît9 c’est-à-dire que des élèves avec des troubles autistiques pourront être orienté•es vers du marketing, n’importe quoi…
Elena Chamorro : des dyspraxiques vers des travaux manuels…
Cécile Morin : et ça c’est très dur, et ça aussi le rapport Dubois Jumel sur l’école montrequ’il y a vraiment cette politique qui fait que des élèves handicapés ont très peu de chance de suivre des études, déjà, et surtout des études générales. Pourquoi ? Parce qu’en fait les ESAT vont recruter dans les ULIS10. Et donc, là, c’est très dur de résister à l’orientation, enfin, tu vois, à cette orientation fléchée quoi. Au niveau du lycée, il n’y a pas d’ULIS dans les lycées généraux, et pourquoi il n’y en aurait pas en fait ?
Quel est votre regard sur les dispositifs ULIS ?
Lény Marques : en fait, on ne nie pas le besoin d’éducation spécialisée, on nie le fait qu’on soit obligé de faire des classes spécifiques, des dispositifs spécifiques, séparés. Et nous, ce qu’on n’aime pas, c’est la ségrégation. On veut que tout le monde ait accès à tout en même temps. Donc, le principe d’éducation spécialisée, oui, mais au sein de la communauté.
Cécile Morin : et c’est pour ça que la loi Celaá de 2020 en Espagne11 est intéressante car elle ne concerne pas seulement les élèves handicapé•es mais aussi celles et ceux qui n’arrivent pas à suivre dans les classes pour plein d’autres raisons que le handicap en fait. Et tu vois, si tu as un•e élève qui n’arrive pas bien à suivre parce qu’il ou elle a des difficultés, tu ne vas pas dire, « Ah non, mais attends, moi, je ne suis pas formé ! », « Ah non, mais attends, moi, j’en ai 30 », tu vas essayer d’adapter ton enseignement, voilà, ces élèves là, il faut aussi les prendre comme ça. C’est à dire que faire un programme qui a été pensé par des gens qui n’ont jamais enseigné et il va falloir le faire, c’est complètement con,en fait, et il y a plein d’élèves qui sont sur le bord de la route, et les élèves qui sont dans les dispositifs ULIS, mais aussi d’autres élèves qui sont dans les classes ordinaires… Donc, c’est ça qu’il faut repenser aussi en fait…
Elena Chamorro : le handicap n’explique pas tout. Et souvent, il y a ce biais épistémique, c’est à dire que tout problème va être mis sur le compte du handicap.
Cécile Morin : là, c’est encore une façon de naturaliser une sorte d’infériorité ou de déficience, alors qu’en fait, il y a d’autres élèves …
Lény Marques : l’école exclut une bonne partie de la population, déjà. Il y a plein de raisons différentes que le handicap, mais on ne se focalise que sur ça.
Cécile Morin : pourquoi ne pas penser à ce compte des aides spécifiques pour d’autres types de problèmes que rencontrent les élèves, avec des enseignant•es spécialisé•es à certains moments, et du coup, ça permet aussi de repenser en fait ce que doit être l’enseignement pour tout le monde.
A quelles conditions l’école française pourra-t-elle se définir comme inclusive ?
Elena Chamorro : le jour où elle s’appellera « école » je pense.
Lény Marques : le jour où on aura le droit d’y aller.
Elena Chamorro : le jour où elle s’appellera « école », où il n’y en aura qu’une d’école, voilà, moi je pense qu’on aura gagné.
Quelles sont les discriminations et les relégations communément vécues par les personnels handicapés à l’école ?
Cécile Morin : quand on, en fait, on veut passer un concours national de la fonction publique, quand tu es handicapé•e, déjà, il faut passer devant une commission pour avoir l’autorisation de le passer. Enfin, moi, ça a été mon cas pour passer les concours d’enseignement. Et puis il y a ça aussi la discrimination à la formation parce qu’il faut le savoir, donc, moi, à mon époque, elle se réunissait deux fois par an, donc, si tu veux, au moment de ton inscription, si tu ne le sais pas, tu l’as raté ton inscription, quoi… En fait, tu sais, en sociologie, on dit que les diplômes, c’est le réseau du pauvre, c’est l’arme du pauvre, c’est l’arme de ceux qui n’ont pas de réseaux Et bien, tu vois, pour une personne handicapée, déjà, accéder à l’école ordinaire, c’est déjà une énorme ambition, et ensuite, les personnes qui réussissent à y accéder, souvent, ils investissent vachement dans le diplôme, parce que c’est l’arme du pauvre, parce que nous, on n’aura pas de réseau, parce que, nous, on n’aura pas de mobilité, tout ce qu’il faut pour réussir, aujourd’hui, on l’a pas quoi… Et, du coup, tu as quand même des élèves handicapé•es qui passent par l’école ordinaire et qui sortent diplômés, tu vois, mais qui ne peuvent pas faire valoir leurs diplômes sur le marché du travail.
Elena Chamorro : et, en fait, je disais tout à l’heure que ce qui est demandé à l’élève au sein de l’école est de s’adapter, c’est à dire c’est l’assimilation. Le maître mot c’est ça. Et bien, pour les personnels, c’est la même chose. Moi, mon expérience, c’est ça. À la fac, au quotidien, on est laissé•es tout le temps dans l’impensé, même si on a des locaux accessibles, ce qui n’était pas le cas quand j’ai commencé à exercer, imparfaitement accessibles, à vrai dire. C’est un travail constant pour s’adapter, y compris en termes de temporalité… ça ne concerne pas que l’accessibilité, ça concerne pas non plus que les résistances. J’ai une collègue qui avait beaucoup de mal à être maître de conf, c’est à dire que la qualité du diplôme c’est l’arme du pauvre, mais c’est une arme moins puissante que celle d’un valide.
Cécile Morin : sur une question qui a été évoquée lors du Grenelle de l’enseignement et de l’éducation nationale organisé par Blanquer, en fait, aujourd’hui, l’évolution de carrière, elle va se faire vachement sur les heures supp. Il faut voir que les personnels handicapés ne font pas d’heures supp. Donc, en fait, comme disait Elena, bon déjà il y a les obstacles, déjà passer des concours, tu as des obstacles législatifs, ok, très bien, ensuite, il faut faire la preuve de ta légitimité, la légitimité, même si tu as des diplômes, elle n’est jamais assurée, et, ensuite, si tu veux, l’évolution de carrière dans l’éducation nationale maintenant elle se fait par ce système, souvent, des heures supp, et bien les personnes handicapées, elles n’en font pas. Donc, il y a tout un tas d’évolutions de carrière, de formation, de passerelles, plus le fait qu’il va falloir faire ses preuves, etc..
Elena Chamorro : non seulement elles ne font pas des heures sup, mais elles font bien souvent des temps partiels pour pouvoir assurer après, ben, la fatigue, le temps, le temps qui n’est pas forcément le fait de notre handicap… moi je sais que si j’ai besoin de trois fois plus de temps, c’est parce que les cheminements ne sont pas toujours les mêmes que pour les valides,… ce n’est pas toujours le fait de mon corps, de mes incapacités corporelles, c’est le fait de la façon dont les choses ont été organisées ou prévues. J’ai fonctionné longtemps par exemple avec un seul toilette au cinquième étage, et des ascenseurs bourrés qui me faisaient perdre un temps fou pour aller aux toilettes… et j’ai fait du temps partiel, qui était de droit, mais que je payais : non seulement je ne pouvais pas faire d’heures sup, mais j’en faisais moins et j’avais une perte de salaire, qui se répercutait sur moi, il n’y avait aucune compensation.
Cécile Morin : c’est ça le handicap en fait, c’est ça, ce que tu décris. C’est-à-dire qu’en fait ce n’est pas toi qui est fatigable, c’est que les obstacles te rendent fatigué•e. Et juste un autre truc : quand tu es élève handicapé•e à l’école ordinaire quand tu as réussi parce que tes parents t’ont fait échapper à l’institution : tu as deux trucs que tu intériorise, c’est qu’il ne faut surtout pas faire de vague, surtout se comporter de façon conforme parce que sinon, si tu es un peu chiant en classe, et bien, hop, ta place ne sera pas assurée. Et ensuite, c’est d’être bon élève. C’est quand même deux trucs que les élèves intériorisent…
SUD éducation se bat pour une école égalitaire et émancipatrice et dans une perspective de transformation sociale. Les analyses de notre syndicat pointent les offensives libérales et réactionnaires comme les principaux freins à la réalisation de cette école. Partagez-vous ces constats ?
Elena Chamorro : non seulement on partage ces constats, mais, on ne l’a pas dit, une lutte antivalidiste est nécessairement anticapitaliste, et on n’a pas nommé non plus tous les courants marxistes qui, lorsqu’on a défini le handicap, comme construction aussi liée au capitalisme, que certains chercheurs ont mis en avant11.
Lény Marques : comme les femmes sont la variable d’ajustement du chômage dans le patriarcat, et bien les handicapé•es servent aussi de variable d’ajustement pour l’emploi, pour plein de choses…
Cécile Morin : tout à fait. C’est à dire que, pour moi, pour un syndicat interpro, il faut vraiment pas séparer la question de l’éducation de la question du travail. Et c’est pour ça que moi j’insiste franchement sur l’effet de filière, c’est à dire que quand on se dit « ils sont mieux en IME » bon, c’est faux, d’accord, mais il ne faut pas voir que l’instant où ils vont être en petits effectifs, il faut voir ce qu’ils vont devenir, comment ils vont alimenter l’exploitation en ESAT…
1. On peut y lire : « pour bien des élèves en situation de handicap scolarisés en établissement spécialisé – pour un tiers d’entre eux, en fait – la scolarisation réduite à une journée ou une demi-journée par semaine, perd toute consistance au point de relever presque de l’abstraction », Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur l’inclusion des élèves handicapés dans l’école et l’université de la République 14 ans après la loi du 11 février 2005, sous la direction des députés Jacqueline Dubois et Sébastien Jumel, 2019, p. 49.
2. Cécile Morin, Le handicap, un impensé de l’enseignement de l’histoire, Carnet de recherche Aggiornamento hist-géo, 2019 : https://aggiornamento.hypotheses.org/4386
3.https://clhee.org/2019/06/23/le-handicap-un-impense-des-enseignements-disciplinaires/
4. https://clhee.org/2020/11/03/sensibiliser-au-handicap-ou-sensibiliser-au-validisme/
5. https://clhee.org/2018/05/28/depolitisation-et-regard-valido-centre-les-mises-en-situation/
6. https://www.arte.tv/fr/videos/RC-021939/un-metre-vingt/
7. https://fr-fr.facebook.com/francetvslash/videos/quest-ce-que-le-validisme-/589258735013982/
8. https://twitter.com/search?q=%23NousElevesHandis&src=typeahead_click&f=top
9. Voir sur ce point l’analyse éclairante de Renaud Guy, coordonnateur d’ULIS et militant CGT Educ’action Handicap, ULIS, scolarisation, présupposés validistes et lycée professionnel, Journée d’études organisée par la CGT Educ’action Rhône/Isère, Lyon, mars 2022 : https://www.youtube.com/watch?v=fHrwpZiciBQ
10. « La France tend donc à dissuader ses enfants en situation de handicap d’entreprendre des études supérieures. Lorsqu’ils s’y lancent tout de même, on les pousse à s’orienter vers la voie professionnelle, sans que cela soit toujours ni souhaité, ni justifié » : Op. Cit.p. 105.
11. http://quefaire.lautre.net/Roddy-Slorach
Une école inclusive, qui pourrait être contre ?
 Pour l’Éducation nationale, il s’agit de répondre à de nouvelles attentes de la société, des parents, et, pour les personnels, d’œuvrer à un réel épanouissement, et une émancipation des élèves en situation de handicap.
Pour l’Éducation nationale, il s’agit de répondre à de nouvelles attentes de la société, des parents, et, pour les personnels, d’œuvrer à un réel épanouissement, et une émancipation des élèves en situation de handicap.
Et pourtant, dans les faits, nous sommes beaucoup à constater amèrement que l’école inclusive telle que nous la souhaiterions n’est pas encore là.
Parmi les explications possibles :
- les collègues sont soumis-es à des injonctions institutionnelles sans déploiement de moyens en conséquence (effectifs de classe, formation, temps de concertation, …)
- la nécessité d’un temps long pour que les représentations des attendus de la scolarité dans la société française évoluent
- l’école est pour l’instant toujours imprégnée d’un fonctionnement méritocratique et élitiste.
Cette situation engendre de la souffrance au travail, un sentiment de culpabilité chez les personnels et, du côté des familles et de l’élève, de l’insatisfaction et un sentiment de non prise en compte de ses besoins.
Alors, quelles solutions possibles ?
Une première réponse réside dans la réflexion syndicale.
SUD éducation a choisi la voie de l’émancipation pour toutes et tous et c’est à travers elle que les professionnels pourront imaginer d’autres chemins.
Il est temps de s’affranchir des pratiques élitistes qualifiées à tort de « républicaines » et de « démocratiques » sous couvert « d’égalité des chances » et de réussite au mérite.
non plus en termes de handicap ou de « singularité » de chacun·e.
Quoi qu’il en soit, de toutes les pistes évoquées ici, il résulte que la mise en place d’une pédagogie réellement inclusive nécessite de gagner au moins trois grandes revendications syndicales :
- du temps de réflexion et de partage, pour penser, coopérer et construire
- une formation (initiale et continue) pour tous les personnels.
- la limitation des effectifs des classes qui comptabilisent les élèves inclu•ses.
Un métier construit dans la précarité
C’est en 2014 qu’est créé le métier d’accompagnant·e des élèves en situation de handicap, appelé AESH. Énième acronyme, mais tout en continuité avec les précédents statuts, notamment celui d’auxi
Les années qui ont précédé ont été celles des premières mobilisations contre les bas salaires, l’absence de perspectives et la précarité, redoublée par le recours massif de la part du ministère aux contrats d’insertion sous toutes leurs formes.
Le nombre de personnels chargés de l’accompagnement des élèves en situation de handicap, de la maternelle au supérieur, n’a fait que croître depuis la loi handicap de 2005 : à peine plus de 10 000 en 2006 contre quasiment 130 000 aujourd’hui.
Pourtant, malgré l’arrivée
S’ouvrir à une réflexion inclusive commence par ce premier pas de côté.
Paradoxe de l’institution : un large panel d’outils qui autorise une programmation adaptée des objectifs d’apprentissage (PAOA, PPS, PAP) et, dans le même temps, un fonctionnement toujours plus sélectif, avec des bulletins de notes, une école du tri, du classement, la mise en compétition permanente des élèves et une pression de la hiérarchie sur les programmes à finir.
Il faut alors s’emparer de ces outils officiels souvent méconnus qui permettent la co-construction d’objectifs partagés par les professionnels qui entourent l’élève à partir de l’analyse des besoins. Il est nécessaire de gagner une véritable formation pour comprendre ces besoins mais aussi du temps de concertation pour les analyser et chercher collectivement des adaptations, sinon ces outils de programmation adaptée resteront chronophages, formalistes et surtout inutiles.
La réalisation de l’école inclusive ne peut donc être menée que collectivement. Le partenariat en est la clé : la famille, les enseignant·es, les AESH, la vie scolaire, le personnel médico-social, les ERSEH, les établissements de santé (SESSAD, CMP, CMPP, HDJ), les établissements spécialisés (ITEP, IME, IMPRo).
Dans la classe, l’enjeu pour les collègues est de répondre à l’hétérogénéité du groupe. Pour cela, les pédagogies alternatives et coopératives sont des vraies pistes : semaines interdisciplinaires, classe puzzle, pédagogie institutionnelle, pédagogie de projets, jeux cadres, autant de dispositifs où l’élève est acteur.rice (et non pas réceptacle de savoir), en interaction avec ses pair·es et qui prennent en compte les besoins de chaque enfant. Une autre façon de penser la pédagogie inclusive est la conception universelle des apprentissages (CUA) qui construit la séance en termes d’accessibilité de contenu et
liaire de vie scolaire (AVS) : des CDD, des temps incomplets imposés, un salaire au SMIC, l’absence de formation. Seule nouveauté de ce nouveau
massive rentrée après rentrée de ces personnels dans les contingents académiques, et dans les écoles et établissements, la reconnaissance institutionnelle et du rôle éducatif et pédagogique des AESH est restée dans les limbes de la dichotomie titulaires versus contractuel·les. Maltraité·es, méprisé·es, ignoré·es, les AESH ont dû s’imposer par elleux-mêmes dans le paysage de l’école pour toutes et tous.
Preuve en est, en juin 2019, le ministère a pensé nécessaire de rappeler dans une circulaire de rentrée que les AESH étaient « membres à part entière de la communauté éducative ».
Des moyens en fonction des besoins versus une logique comptable
Cette circulaire vient également modifier le cadre d’emploi : fini le recours aux contrats d’insertion et aux contrats courts, place… aux CDD de 3 ans ! Dans la communication du ministère, cela équivaut à des mesures de déprécarisation. Pourtant, les conditions statutaires et salariales restent les mêmes : on y verra plutôt une vision assumée de la précarité structurelle, dans la droite ligne de ce qui s’annonce pour l’ensemble de la Fonction publique.
Septembre 2019, c’est également la première phase du déploiement des PIAL : les pôles inclusifs d’accompagnements localisés. Derrière cet acronyme, c’est la logique de mutualisation à outrance des moyens qui prévaut : les AESH accompagneront de plus en plus d’élèves, et ces dernier·es bénéficieront de moins en moins d’heures. Au ministère et dans les rectorats on sort les calculatrices pour établir des taux d’accompagnement et ne pas dépasser les seuils fixés par la rue de Grenelle. S’il faut pour cela qu’un·e AESH accompagne jusqu’à 6 élèves, et bien ce sera le cas, et le maître-mot d’autonomie viendra vernir le décor, peu importe les besoins réels de l’élève et… la construction de son autonomie.
Trois ans après, ça grince au sein même du ministère, puisque dans son rapport annuel publié en juillet 2022, la médiatrice de l’Éducation nationale met un coup de pied dans la fourmilière, dénonçant à demi-mot les PIAL.
La logique validiste de la précarisation
Ce qui transparaît derrière tout cela, c’est le faux-semblant de l’inclusivité ministérielle. Dans la région de Nantes, personnels et parents d’élèves en lutte écrivaient : « sans les moyens, l’école inclusive n’est qu’un slogan ».
Pour une école réellement inclusive, c’est-à-dire une école qui se donne les moyens d’accueillir tou·tes les enfants, quels que soient leurs difficultés et leurs besoins, il faut tout mettre à bas et tout repenser : du bâti aux programmes, du nombre d’élèves par classe à la pédagogie, réellement former tou·tes les professionnels, former des enseignant·es spécialisé·es…
Les AESH sont un pilier de cette école que nous avons à cœur et que nous revendiquons, mais dans de toutes autres conditions ! C’est le sens de nos revendications pour un statut de fonctionnaire (et une titularisation sans condition !) et la création d’un nouveau métier d’éducateur·trice scolaire spécialisé·e. Ce changement de dénomination vient rompre avec la logique de précarisation des métiers du care, métiers largement féminisés (plus de 90% pour ce qui concerne les AESH), sous-payés et déconsidérés. Cette maltraitance salariale agit comme un miroir des logiques handiphobes de l’État : parce qu’il s’agit d’accompagner des enfants handicapé·es, on peut se permettre de précariser.
Dans la même logique, parce qu’il est communément considéré que “tout le monde peut faire ça”, on ne forme pas les personnels. Les 60 heures de formation initiale (quand elles ont lieu) et la rarissime offre de formation continue sont loin d’être à la hauteur des exigences. Pourtant, accompagner des élèves en situation de handicap dans leur parcours et leur vie scolaire ne peut pas s’improviser, tout autant que les pratiques professionnelles nécessitent une formation tout au long de la carrière, pour les ré-interroger et les approfondir.
Au cours des mobilisations menées par les personnels AESH depuis deux ans, une réflexion est menée pour penser ensemble les questions salariales-statutaires et la défense d’une école réellement inclusive. C’est de la nécessité de cette articulation qu’il faut convaincre pour que nos luttes les fassent résonner ensemble, pour une autre école, égalitaire, émancipatrice, et non-validiste, loin des marécages réactionnaires !
Étudiant·es et personnels en situation de handicap dans l’ESR
Les étudiant·es en situation de handicap à l’université : état des lieux, sélection et discriminations visibles et invisibles... peut (largement) mieux faire !
Depuis la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, le nombre d’étudiant·es en situation de handicap (ESH) a été multiplié par 5 dans les établissements de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (ESR). En 2019, on comptait près de 40 000 ESH déclaré·es soit 1,82% de la population étudiante. Il faut cependant rester prudent puisque ce chiffre ne reflète non pas la population d’ESH mais bien celle qui s’est déclarée auprès des structures handicap de leur établissement.
Par ailleurs, les ESH se répartissent de manière inégale et orientée au sein des filières et des niveaux : sur-représenté•es en Licence et dans les études courtes (BUT), les ESH le sont aussi dans les filières de sciences humaines et sociales (SHS), quand des procédures de ségrégation voire de quasi-exclusion (Médecine) peuvent encore exister au sein de certaines filières. On constate aussi au niveau national une surreprésentation des ESH femmes (57%). Des disparités discriminantes qui perdurent donc malgré l’obligation de garantir des mesures de compensation du handicap pour les établissements.
Comme le reste de la société, les universités se sont tout d’abord centrées sur les handicaps visibles (et principalement moteurs) et donc sur les questions d’accessibilité physique des locaux. Cette approche reste pourtant largement validiste puisqu’elle vise à simplement éliminer quelques obstacles tout en restant dans un environnement inhospitalier et difficile (voire agressif) pour les ESH. Pire, elle ne prend jamais en considération les diverses formes de handicap psychique (états dépressifs, encombrement psychique…). Il ne suffit pas de pouvoir se rendre en cours pour que soient réglées toutes les questions d’accessibilité à l’ensemble des activités liées à l’enseignement, à la pédagogie et à la recherche. En parlant « d’étudiant·es en situation de handicap », il s’agit de mettre l’accent sur l’interaction entre une personne et ses caractéristiques individuelles et son environnement, à rebours des notions libérales individuelles, de normes mais aussi d’une approche universaliste qui certes publicise l’accessibilité de l’environnement universitaire, mais en tentant de tout normaliser sans prendre en compte l’ensemble des interactions qui se jouent entre les ESH et l’ensemble de la communauté universitaire.
Dans cette acceptation « interactive », la question du handicap devient une question principalement sociale et non plus médicale. À l’Université pourtant, l’accompagnement des ESH relève de quelques personnels des structures handicap et des services de santé des étudiant·es (SSE) et de quelques enseignant•es référent•es alors que celui-ci devrait être pris en charge collectivement. C’est à l’ensemble de la communauté universitaire, des étudiant·es aux enseignant•es en passant par les personnels BIATSS de prendre en compte et en charge cette dimension de la vie sur un campus et dans les salles de cours.
Mais cela ne pourra se faire sans moyens supplémentaires conséquents alloués. Comme dans l’Éducation nationale, l’Université « inclusive » a plus été un slogan qu’une réalité. Avec 65% des jeunes entre 15 et 24 ans en situation de handicap sans diplôme contre 15% des jeunes au sein de cette tranche d’âge, la formule politique oxymorique « d’égalité des chances » manifeste ici toute sa vacuité. En réalité, soit c’est « l’égalité » et le MESRI comme les établissements doivent mettre en place toutes les mesures d’accompagnement et de compensation du handicap, soit c’est « les chances » et donc, dans les faits, des mécanismes de sélection invisibles (quand ils ne sont pas ouvertement visibles dans certaines filières).
Accompagné·es un peu plus individuellement (malgré toutes les limites pointées dans ce dossier) lors de leurs études secondaires, les ESH subissent plus difficilement que les autres néo-étudiant·es la transition dans l’ESR. Cette transition est marquée par une certaine complexité, une demande d’autonomie, une variabilité nécessaire, une souplesse... tant d’aspects de la vie universitaire qui sont profondément inégalitaires au regard de plusieurs critères : sociaux, de genres, géographiques... et bien évidemment de handicap. Plus que les autres étudiant·es, les ESH réfléchissent plus rapidement en termes de ce qui est « possible », « réalisable », « accessible » pour elles et eux.
On voit bien ici qu’il ne suffit donc plus de simplement délimiter quelques places handicapés ou équiper quelques amphis de boucles magnétiques pour prendre en compte toute la diversité des situations de handicap des ESH et répondre à leurs besoins dans une perspective d’inclusion, toutes les barrières visibles ou invisibles et toutes les limitations matérielles comme pédagogiques que subissent les ESH.
Sans moyens, l’université inclusive n’est qu’un slogan
Si le nombre d’ESH a été multiplié par 5 depuis 2005, les moyens et les ressources n’ont pas suivi cette trajectoire. Que ce soit en termes de ressources humaines au sein des structures handicap (chargé·es d’accompagnement handicap) et des SSE ou en termes de budget alloué pour l’ensemble des mesures au sein des établissements de l’ESR. Partout, il manque de salles, il manque de surveillant-es d’examens, de scribes ou de lecteurs et lectrices, des emplois du temps adaptés...
Dans les faits cela se traduit donc par une automatisation des mesures de compensation et trop souvent, du bricolage. Les mesures de compensation, d’aménagement et d’adaptation peuvent prendre diverses formes : temps majoré pour les examens, matériel pédagogique adapté, aides humaines et techniques, accompagnement pédagogique... Malheureusement, par manque de temps et de personnels, ces mesures ont tendance à être plus automatiques que pensées individuellement pour chaque ESH, sans parler d’un manque criant de bilans collectifs sur la faisabilité et l’intérêt (ou non) de ces mesures.
Du côté enseignant•es, celles et ceux ci sont trop souvent mis·es devant le fait accompli de devoir adapter leurs cours et leurs examens, sans réflexion commune, sans compréhension parfois des enjeux, sans formation spécifique, en grande partie faute de moyens supplémentaires accordés. Les référent·es handicap des composantes ne se voient dégager aucun volume horaire d’enseignement pour ce travail qui relève donc plus du bénévolat que d’une véritable mission professionnelle (inscrite pourtant dans le Code de l’éducation). Dans ces conditions, on fait bien souvent « au mieux », au détriment des droits des ESH.
Lors de son congrès de 2022, SUD éducation a adopté cette base revendicative à ce sujet :
- le recrutement conséquent et la formation de personnels au sein des services de médecine préventive et des structures handicap,
- des dotations horaires et une formation pour les EC assurant le suivi des ESH,
- une réflexion et prise en charge collective des ESH par l’ensemble de la communauté universitaire.
Et du côté du personnel ?
Depuis 1987, l’État comme tout employeur se doit d’atteindre 6% d’agent-es en situation de handicap dans ses administrations. Et dans l’ESR comme dans la majorité des cas, on est loin du compte. Tout simplement parce que l’état a créé les conditions pour y déroger, en permettant aux établissements publics de cotiser aux FIPHFP (Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique) et ne pas satisfaire ces 6%. Selon les bilans sociaux du MESRI, le taux d’emploi de personnel en situation de handicap (PSH) tourne autour de 3%. Mais avec ici aussi des disparités tranchantes : moins de 1% des EC et C sont en situation de handicap.
Que ce soit via la voie normale du concours ou via la voie contractuelle spécifique (BOE) le bât blesse : en 2018 seuls.... 5 postes ont été pourvus pour des EC en situation de handicap. Ainsi, on le sait, souvent, sans intervention volontaire des organisations syndicales, la vigilance et la formation aux recrutements de PSH /personnels en situation de handicap par la voie normale ou la voie contractuelle restent bien insuffisantes dans l’ESR.
Pour l’ensemble des PSH, le droit à la compensation - article 11 de la loi du 11 février 2005 - est un dispositif spécifique ou un ensemble de mesures apportées à une personne bénéficiant d’une RQTH. Mais celle-ci ne se résume pas à une prestation financière ou à un aménagement technique de poste. Elle doit être appliquée tant en matériel adapté qu’en aménagement de temps de travail et d’objectifs assignés et/ou d’accompagnement humain, sans pour autant pénaliser les équipes.
Avec la dite « modernisation de la Fonction Publique », les suppressions de postes et le nombre d’agent-es en souffrance se multiplient, et parmi elles et eux se cachent notamment des PSH ou en arrêt de longue maladie. Que ce soit à travers le télétravail « imposé » ou le travail isolé, ces dispositifs, loin de trouver des solutions aux questions de handicap, restent trop souvent des palliatifs qui à terme contribuent à un éloignement des collectifs de travail et sont donc constitutifs de discriminations.
Renforcer l’accompagnement de proximité doit être une priorité dans les services : toute prise en charge ou compensation du handicap implique comme condition sine qua non de créer localement, voire sur chaque site, une fonction de référent·e ou correspondant-e, occupée par une personne compétente et suffisamment formée. Afin que le droit à la compensation soit appliqué dans toutes ses dimensions, les établissements doivent garantir :
- Un·e référent-e handicap de proximité, en capacité d’intervenir sur chaque site pour s’assurer du bien-être au travail des PSH et de leurs collègues.
- Un aménagement du temps de travail pour les PSH (journées de travail à durée réduite définie par la médecine de prévention, afin de tenir compte de la fatigue liée au handicap, non subie par les autres collègues)
- Une réorganisation du travail et une adaptation des postes de travail intégrant aussi celui occupé en télétravail - pour cela, des moyens financiers nécessaires doivent donc être débloqués.
- Le dégagement de moyens supplémentaires pour l’ensemble des professions impliquées par le suivi du handicap (médecine du travail, ergonomie, prévention…) et par la sauvegarde des missions des CHSCT, mises en péril par le gouvernement via la LTFP.
-
Les personnels handicapés : droits & conditions de travail

Le ministère de l‘Éducation nationale emploie 3,6% de personnels en situation de handicap. On est donc loin de l’obligation légale d’employer au moins 6% de travailleurs·euses en situation de handicap pour les entreprises d’au moins 20 salarié·es et les employeurs publics.
Bénéficier d’une RQTH (reconnaissance en qualité de travailleuse et travailleur handicapés) donne des droits mais ceux-ci sont parfois soumis à l’aval du médecin du travail.
Il existe aussi des dispositifs pour améliorer les conditions de travail des personnels en situation de handicap.Cependant, les démarches pour en bénéficier sont souvent longues et complexes et ne sont pas toujours retenues par l’administration.
Définition du handicap selon la loi du 11 février 2005
La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005 définit le handicap de la façon suivante :
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour obtenir une reconnaissance de travailleur·euse handicapé·e, il faut constituer un dossier auprès de la MDPH (maison départementale des personnes handicapées). Il peut être utile (mais pas obligatoire) de faire déterminer un taux d’incapacité. Par exemple, si le taux d’incapacité de la personne en situation de handicap est égal ou supérieur à 80%, celle-ci peut bénéficier d’avantages notamment fiscaux.Droits des personnels en situation de handicap à l’Éducation nationale
Le temps partiel de droit - Les personnels bénéficiaires de l’obligation d’emploi, après avis du médecin du travail, peuvent bénéficier d’un temps partiel de droit pour une année scolaire renouvelable deux fois.
Départ à la retraite anticipée - Un·e agent·e peut partir à la retraite avant 62 ans( au plus tôt à partir de 55 ans) s’iel remplit certaines conditions de durée d’assurance retraite et de durée cotisée. Il faut pour cela être atteint·e d’un taux d’incapacité d’au moins 50% pendant les durées exigées. Dans le cas où iel remplit la durée d’assurance vieillesse exigée mais sans justifier de la reconnaissance administrative de son handicap pour ces périodes, iel peut valider sa demande à condition d’avoir une incapacité permanente d’au moins 80% au moment de la demande.
Droit à la formation - L’ensemble des formations sont accessibles aux agent·es en situation de handicap incluant la préparation aux concours. Si besoin, les formations sont aménagées en fonction du handicap (tiers-temps pour les concours, par exemple). Il existe aussi un droit à une formation spécifique destinée à compenser leur handicap.
Priorité pour les mutations - Une bonification de droit au titre du handicap de 100 points est accordée lors des mutations inter. Attention, elle n’est pas automatique ! Les agent·es concerné·es doivent fournir la notification MDPH à chaque demande. Une bonification sur dossier de 800 points(1er degré) ou 1000 points( 2nd degré) peut être accordée après avis médical. Les critères d’attributions sont opaques. Le nombre de points de ces deux bonifications au titre du handicap attribué à l’intra varie selon les académies et portent sur des vœux larges. Les deux bonifications ne sont pas cumulables.Conditions de travail des personnels en situation de handicap
En règle générale, quand une personne est confrontée à une situation médicale difficile, elle peut demander au médecin du travail des préconisations pour améliorer ses conditions de travail. Les préconisations du médecin ne sont pas des injonctions mais quand elles sont refusées par l’administration celle-ci doit motiver par écrit sa décision et en informer le CHSCT.
L’aménagement de poste - Il est à renouveler tous les ans. Il faut constituer un dossier à envoyer au médecin conseil du Recteur d’académie qui donnera un avis. Il peut constituer, par exemple, en une mise à disposition de matériel spécifique, une aide humaine ou un aménagement d’emploi du temps.
L’allègement de service - Il permet de réduire le temps de travail en conservant un salaire à plein traitement. C’est une mesure exceptionnelle qui est accordée aux agent·es qui doivent recevoir des traitements médicaux lourds mais qui souhaitent continuer leur activité.
Définition du projet professionnel - Il permet de faire un bilan de compétence pris en charge financièrement par le FIPHFP, fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, mais seulement si l’agent·e ne peut plus exercer les fonctions pour lesquelles iel a été recruté·e et si les aménagements de poste ne sont plus possible pour le maintien dans l’emploi.
Affectation sur un emploi de même grade - Si l’aménagement de poste est impossible ou insuffisant, la nouvelle affectation est prononcée après avis du comité médical après un CLM, un CLD ou un CMO de plus de six mois. Dans les autres cas, l’avis du médecin du travail peut suffire.
Affectation sur un poste adapté - Il existe deux type de poste adapté : de courte durée (un an renouvelable deux fois) et de longue durée (4 ans renouvelable sans limite).
Affectation sur un poste adapté au CNED - Elle est réservée aux enseignant·es atteint·es d’une affection chronique invalidante et définitivement inaptes à un enseignement devant élèves. L’aptitude à une utilisation de l’outil numérique est indispensable. Le nombre de postes au CNED est très limité.
Le reclassement - Il est possible en cas d’inaptitude temporaire ou définitive constatée par le comité médical. Si l’administration n’est pas en mesure de le proposer sur un autre emploi, l’agent·e est mis·e en retraite anticipée, L’agent·e a droit à une période de préparation au reclassement d’une durée maximale d’un an à plein traitement.
Si vous êtes confronté·e à des difficultés d’intégration, aux préjugés ou tout type d’incompréhension liés au handicap de la part de vos collègues ou chef·fes d’établissement vous pouvez demander au correspondant handicap de votre académie d’intervenir dans le cadre d’une formation pour sensibiliser l’ensemble des personnel au handicap sur votre lieu de travail.
Précarité et handicap : de l’école au monde du travail
2,8 millions de personnes en âge de travailler ont une reconnaissance administrative d’un handicap ou d’une perte d’autonomie. Selon les chiffres de 2021 de la Drees, 19 % des personnes handicapées vivent sous le seuil de pauvreté contre 13 % dans la population générale. Les personnes handicapées travaillent davantage à temps partiel et sont également surreprésentées parmi la population au chômage : 16% contre 8% dans le reste de la population. Ces chiffres interrogent : comment expliquer la précarité dans laquelle vivent les personnes handicapées dans notre société ?
Précarité et exploitation au travail
La loi de 1987 crée l’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées) qui a, officiellement, pour but de favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées dans les entreprises du secteur privé, ainsi que le minimum de 6% de personnes handicapées dans l’effectif des entreprises d’au moins 20 salarié·es. L’obligation était toutefois portée à 10% avant 1987. Cette obligation s’impose aussi bien aux entreprises privées, qu’aux administrations publiques ou encore aux collectivités territoriales.
Pour s’acquitter de cette obligation d’emploi, l’employeur peut soit employer directement des personnes bénéficiaires de l’OETH, soit passer des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service avec le secteur adapté, le secteur « protégé » (les ESAT) ou des travailleurs indépendants handicapés, soit accueillir des stagiaires handicapés, soit en versant une contribution à l’AGEFIPH, soit en appliquant un accord de branche, d’entreprise, d’établissement, ou de groupe, prévoyant un programme annuel ou pluriannuel en faveur des personnes handicapées. Ces mesures sont très largement insuffisamment contraignantes pour les employeurs puisqu’en 2020 on ne comptait que 3,5% de personnes handicapées parmi les salarié·es du secteur privé. L’Agefiph s’est fixé pour objectif une augmentation de 150000 à 200000 salarié·es handicapé·es, soit un taux de 4%, pour 2024 afin de lutter contre le chômage et la précarité.
Les personnes handicapées sont employé·es sur des postes ordinaires grâce à des lois de discrimination positive et de quotas qui doivent permettre de favoriser l’emploi, mais aussi sur des postes subventionnés, lorsque les employeurs reçoivent des aides publiques pour compenser les surcoûts importants liés à l’adaptation d’un poste de travail pour un·e salarié·e handicapé·e, et sur des postes du « secteur protégé », c’est-à-dire dans les institutions, les ESATS.
Les ESATS font l’objet de critiques virulentes de la part des militant·es antivalidistes qui les décrivent comme des lieux d’exploitation et de violences à l’encontre des travailleurs et des travailleuses handicapé·es. Cette violence est par ailleurs décrite par Thibault Petit dans son récent livre Handicap à vendre, fruit d’une enquête de 6 ans sur les rouages du travail en ESAT. 1500 ESATS accueillent 120 000 personnes handicapées psychiques ou cognitifs à 90%. L’état désigne des unités de sous-traitance pour les entreprises qui font travailler des personnes handicapées sans leur reconnaître le statut de salarié. Les travailleurs et les travailleuses des ESATS perçoivent un salaire dont le montant représente en moyenne seulement 11% du Smic. Avec l’aide que l’État verse à l’établissement, le revenu mensuel atteint 715 euros nets pour 35 heures de travail hebdomadaire. Les travailleurs et les travailleuses des ESATS ne sont pas considéré·es comme des salarié·es mais comme des usager·es pour qui le Code du travail ne s’applique pas : pas de droit de grève, pas de conventions collectives. Ici l’exploitation se pare du vocable « d’action sociale ». Le secteur de l’emploi « protégé » est extrêmement rentable pour les entreprises car en sous-traitant aux ESATS, les entreprises sont libérées de l’obligation d’emploi de 6% de salarié·es handicapé·es au sein de l’entreprise. La loi de 1987 portant le quota de 10% à 6% a fait la promotion des ESATS, ainsi le recours à ces institutions permet aux entreprises qui ne respectent pas le quota, pourtant abaissé, de ne pas être sanctionnées. Les conditions de travail sont souvent éprouvantes en ESAT : les tâches sont répétitives et l’environnement de travail paternaliste est propice aux violences, aux humiliations et aux brimades. Dans les ESATS, les travailleurs et les travailleuses handicapé·es sont largement dépossédé·es de leur pouvoir de décider, la parole leur est confisquée.
L’ONU a dénoncé les conflits d’intérêt omniprésents dans les institutions françaises. Ainsi à la MDPH, l’UNAPEI siège à la fois en tant qu’association gestionnaire et en tant qu’association de défense des intérêts des personnes handicapées, il en est de même dans la gestion des ESATS. L’obtention de droits pour les travailleurs et les travailleuses des ESATS est un enjeu majeur pour le monde du travail. Pour aller encore plus loin dans l’exploitation, des ESATS hors les murs sont actuellement en train de se développer afin d’amplifier les possibilités d’exploitation des personnes handicapées par les entreprises, tout en « se donnant bonne conscience » .L’école, antichambre de l’exploitation ?
Après avoir fait le constat d’une pauvreté plus forte des personnes handicapées, il reste à interroger la responsabilité de l’école. À la rentrée 2022, on compte 430000 élèves en situation de handicap dont 67000 en établissements hospitaliers ou en instituts médico-sociaux. Le service public d’éducation compte 10 272 dispositifs d’unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS). En IME comme dans les écoles, collèges et lycées, les personnels dénoncent le manque de moyens, de personnels et de formation.
L’école, comme les IME, préparent les personnes handicapées à un monde du travail largement discriminant à leur égard : les élèves handicapés sont davantage voué·es à occuper des emplois plus pénibles et moins bien rémunérés. 74% des bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont des ouvrier·es et des employé·es contre 50% de la population générale. On remarque que l’orientation dans les différents « parcours » de formation résulte en partie de la position sociale de la famille des élèves : plus les élèves sont issu·es d’un milieu favorisé, plus ils et elles seront scolarisés dans des classes ordinaires, plus les élèves sont issu·es d’un milieu défavorisé, plus ils seront accueillis dans des institutions spécialisés.
En IME, les élèves bénéficient en moyenne de 6h de cours par semaine, pour un tiers d’entre elles et eux le temps scolaire ne dépasse pas une journée par semaine, voire une demi-journée. De nombreux collectifs militants antivalidistes s’appuient sur des rapports internationaux comme ceux de l’ONU pour revendiquer la fermeture des IME et le transfert de leurs moyens et des personnels dans le service public d’éducation. Ces collectifs considèrent que les institutions telles que les IME participent du système de ségrégation et d’enfermement des personnes handicapées et de maltraitance à leur égard. Ces centres ne préparent pas les personnes handicapées ni à une vie sociale autonome ni à exercer un métier. En France, on compte 30 0000 enfants et adultes qui vivent en établissement, séparé·es du reste de la société.
Lorsque les enfants handicapé·es sont scolarisé·es en milieu ordinaire, ils et elles peuvent, au terme d’un parcours semé d’embûches, rejoindre soit une Ulis, soit bénéficier d’un accompagnement par un·e AESH. Si le ministère prévoit l’ouverture d’Ulis dans les lycées généraux, on remarque que le déploiement des Ulis témoigne d’une surreprésentation des élèves handicapés dans des filières dévalorisées qui conduisent à des métiers mal rémunérés. Les Ulis sont principalement implantées en école, en collège et en lycée professionnel et très peu en lycée général. Ainsi les élèves handicapés sont davantage orienté·es en lycée professionnel soit dans des filières dévalorisées (PSR par exemple) soit en fonction de la présence d’une Ulis et non d’un choix de filière : l’orientation des élèves handicapés semble par conséquent davantage subie. La fermeture des filières générales aux élèves handicapé•es conditionne la poursuite de leurs études et leur avenir professionnel. En 2019, on ne compte qu’1,6% d’étudiant·es handicapé·es à l’université. Ce constat doit nous interroger sur la place des élèves handicapés à l’école et le rôle des dispositifs qui les accueillent. L’enseignement spécialisé hors de la classe, dans les instituts ou dans les dispositifs Ulis, est externalisé, relégué hors de l’espace normatif de la classe ordinaire. On peut penser que, parce qu’il y a un « ailleurs », un espace hors de la classe adapté aux élèves handicapé•es, l’institution a tendance à considérer que si un élève a des difficultés, s’il ne « s’adapte » pas, alors sa place n’est pas en classe mais dans cet “ailleurs”, l’Ulis, l’IME, la classe relai ou encore la Segpa, sans remise en question de l’espace normatif de la classe. On retrouve les mêmes mécanismes que dans le monde du travail : la non-adaptation de l’entreprise aux salarié·es handicapé·es justifie le recours à « l’emploi protégé » dans les Esats, alors qu’en réalité, tant qu’il y aura des Esats, les entreprises n’adapteront pas les conditions de travail aux salarié·es handicapé·es. De même, à l’école, l’existence de dispositifs ou de structures spécialisées dédouane l’institution de transformer l’école pour la rendre accessible aux élèves handicapé•es. Militer pour la scolarisation des élèves handicapé•es dans les classes ordinaires conduit d’une part à revendiquer les moyens de cette scolarisation, à commencer par une baisse du nombre d’élèves par classe et la présence de personnels spécialistes du handicap, et d’autre part à transformer nos pratiques pédagogiques.Les conditions de scolarisation des élèves handicapés conditionnent leur avenir professionnel. À nous, personnels de l’Éducation nationale, de nous battre pour revendiquer les moyens de leur donner les mêmes chances qu’aux autres élèves, pour que les élèves handicapé·es aient accès à une véritable scolarité.
L’obligation d’emploi des travailleurs et des travailleuses handicapé·es dans l’Éducation nationale, ça donne quoi ?
Dans l’Éducation nationale, on compte seulement 3,5 % de personnels handicapés. Ces personnels sont largement discriminés dans leur vie professionnelle. On compte peu de mesures d’adaptation et celles-ci sont sans cesse remises en cause et soumises à des réévaluations. Les personnels en situation de handicap sont trop souvent dépendant·es du bon vouloir de leur hiérarchie dans l’adaptation de leurs conditions de travail sans que la médecine du travail, réduite à peau de chagrin (80 médecins pour 1 million de personnels) ne puisse jouer réellement son rôle. Par ailleurs, la politique de rémunération au mérite et d’augmentation des heures supplémentaires est largement défavorable aux personnels handicapés dont l’augmentation du temps de travail nuit davantage à leur santé. Le manque d’adaptation des conditions de travail a pour conséquence une fatigue supplémentaire, pourtant les personnels handicapés sont plus mal noté·es par leur hiérarchie qui leur reproche plus souvent un manque d’investissement dans les projets de l’établissement par rapport à d’autres collègues valides.
En Italie, «inclusion» signifie économie, précarité et privatisation
La Confederazione Unitaria di Base - CUB est une des organisations appelées Syndicats de Base en Italie. Ainsi que l’Union syndicale Solidaires, la CUB est co-animatrice du Réseau Syndical international de solidarité et de luttes depuis sa création en mars 2013.
Les décrets, les circulaires et les lois émanant du ministère de l’Éducation en Italie sont remplis de mots comme « inclusion », « accueil », « besoins éducatifs », etc . Apparemment, selon ce qui est écrit dans les textes, l’école italienne est attentive aux enfants et aux jeunes handicapé•es ou ayant des problèmes psychologiques et sociaux. Mais ce ne sont que des mots et rien d’autre : la vérité est que la condition des enfants et des jeunes dans l’école italienne est dramatique.
Au cours des dernières années, en raison des coupes dans les écoles publiques opérées par les différents gouvernements - coupes qui servent à financer les banques et les multinationales - le nombre des soi-disant enseignant•es de soutien, c’est-à-dire des enseignant•es spécialisé•es, a été considérablement réduit, engagés par l’État, qui ont pour mission d’accompagner les enfants handicapés pendant leur parcours scolaire. Le service a été largement privatisé : cette fonction, qui était autrefois exercée par des fonctionnaires, est aujourd’hui souvent confiée à des coopératives d’éducation privées. La figure de l’éducateur·trice privé·e ou celle du ou de l’enseignant·e contractuel·le a remplacé celle de l’enseignant·e de soutien qui sur le papier devrait être spécialisé·e pour l’accompagnement des élèves en situation de handicap. Les éducateur·trices jouent un rôle très important, ils sont souvent des professionnels de qualité mais - et c’est le plus grave – ils et elles sont sous-payé·es. Un·e éducateur·trice travaille deux fois plus et gagne moins qu’un·e enseignant·e de soutien (il faut rappeler que même les enseignant·es publics en Italie gagnent très peu). Pendant les phases aiguës de la pandémie, lorsque les écoles étaient fermées, les éducateurs et éducatrices ont été “laissé·s” à la maison sans salaire pendant plusieurs mois et pendant l’été, ils n’ont jamais de salaire. C’est pourquoi, dans de nombreuses villes (à Rome, en particulier), une lutte des éducateurs et éducatrices pour l’internalisation, c’est-à-dire pour être embauchés par l’État, est en cours.
Même les enseignant·es de soutien engagé·es par l’État vivent une situation de grave malaise. La plupart d’entre eux et elles sont précaires et forcé·es pendant des années à changer d’école chaque année : cela empêche la continuité dans la fonction éducative et provoque aussi des traumatismes chez les étudiants eux-mêmes, qui auraient besoin de retrouver d’année en année les mêmes figures de référence. En outre, il y a souvent une pénurie d’enseignant·es de soutien, car les écoles pour les former sont fermées : il arrive donc que l’on utilise des enseignant·es précaires d’autres disciplines qui ne parviennent pas à enseigner leur discipline (à cause des réductions d’heures). Il n’est pas rare d’avoir un·e professeur·e d’histoire et d’art précaire, totalement dépourvu·e de formation dans le domaine d’une pédagogie inclusive, contraint·e d’accompagner un•e élève handicapé•e pour avoir un salaire. Tout cela, bien sûr, se traduit par
un problème pour les élèves et leurs proches.À cela s’ajoute une situation dramatique de la construction scolaire : manque de salles de classe et d’espaces pour les élèves handicapé•es ; en théorie depuis la loi de 2009, les classes avec un•e élève handicapé•e ne devraient pas dépasser le nombre de 20 élèves, mais cette loi n’est jamais respectée car le ministère lui-même parle de « dérogations à la norme par manque d’espace ». L’exception prévue dans la loi devient finalement la règle. Les classes avec un ou plusieurs élèves handicapés sont toujours nombreuses et bondées.
Tout cela ne trouve aucune réponse dans l’école italienne : ce sont les enseignant·es qui doivent, dans la solitude et sans formation, tout gérer. Dans les écoles il y a la figure du psychologue scolaire, mais il s’agit d’un·e seul·e psychologue pour des milliers d’élèves : les temps d’attente pour avoir une rencontre sont très longs.
Entretien avec le collectif handi-féministe des Dévalideuses
Nous avons rencontré Julie des Dévalideuses, une association qui défend les revendications des femmes handicapées. C’est un collectif féministe, anti-validiste et intersectionnel.
C’est quoi les Dévalideuses ?
C’est un collectif sur le plan national. Il est en double non-mixité c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’hommes cis et qu’il n’y a pas de personnes valides. Il faut avoir la double condition pour faire partie des personnes actives aux Dévalideuses mais il est possible de faire une adhésion de soutien pour tout le monde. Notre objectif, c’est de visibiliser les oppressions croisées qu’on peut subir lorsqu’on est une femme et en situation de handicap.Est-ce que tu peux décrire ces oppressions croisées ?
Quand on est une femme en situation de handicap, ça crée des choses différentes. Ça n’est pas simplement l’accumulation du validisme et du sexisme. Par exemple, souvent, dans les mouvements féministes, les femmes dénoncent le fait d’être ramenées à leur corps et d’être considérées plus comme des objets sexuels que comme des personnes. À l’inverse, les femmes handicapées, souvent, sont considérées en dehors du champ de la sexualité c’est-à-dire que les gens ne vont pas les considérer comme de potentielles partenaires sexuelles ou de relation affective, amoureuse, etc.Est-ce qu’aux Dévalideuses vous avez eu des retours d’élèves ou d’étudiantes sur leur vécu ?
Parmi les Dévalideuses on a des personnes qui sont en situation de handicap depuis leur naissance et donc qui ont vécu l’institutionnalisation par exemple dans des établissements médico-sociaux quand elles étaient petites. Il y a eu aussi l’année dernière l’histoire d’une jeune femme étudiante en droit qui a subi des discriminations pour pouvoir passer ses examens. Ça a été rendu public via Mediapart.En quoi, pour les Dévalideuses, le capitalisme renforce le système validiste et patriarcal ?
Pour nous, le capitalisme, c’est très lié avec le validisme puisque c’est deux rapports de domination qui se nourrissent l’un l’autre. Dans le système capitaliste, l’objectif est de faire du profit et donc de faire en sorte d’avoir des travailleurs et des travailleuses les plus productifs et les plus productives possible. Le capitalisme met une norme de capacité au travail et demande toujours plus aux gens qui travaillent en disant que si vous n’y arrivez pas, c’est que vous avez sans doute un handicap. Il exclut donc les personnes qui ne sont pas en capacité de suivre les cadences, etc.Vous vous revendiquez handi-féministes : qu’est-ce que ça veut dire ?
L’handi-féminisme, c’est le fait de dénoncer les oppressions, les violences subies spécifiquement par les femmes en situation de handicap. Par exemple, les femmes handicapées sont beaucoup plus victimes de violences que les femmes dans leur globalité. C’est plus compliqué pour une femme handicapée victime de déposer plainte. Le système de l’AAH qui est conjugalisée* place aussi les femmes handicapées dans des situations qui contribuent à la survenance de ce type de violences ou en tout cas qui contribuent à rendre plus difficile pour elles de s’en extirper. La conjugalisation de l’AAH, ça veut dire que l’allocation adulte handicapé est calculée en fonction de nos revenus propres et des revenus de notre conjoint ou conjointe, ce qui crée une forme de dépendance. Si on est en couple avec quelqu’un qui gagne de l’argent, l’AAH est diminuée voire supprimée totalement. Il y a aussi d’autres difficultés : il y a très peu de logements accessibles PMR par exemple, d’établissements qui accueillent des femmes victimes de violences qui ont des espaces accessibles PMR… Tout ça fait que c’est impossible pour elles de partir de chez elles.Le droit à la maternité des femmes handicapées est souvent bafoué. Est-ce que tu peux en parler un peu ?
Il y a le problème des jeunes femmes placées en institution qui sont privées de leur droit d’avoir des relations affectives ou des relations sexuelles avec qui elles veulent. Le système de l’institution va cadrer leurs sorties, leurs relations, etc. Dans le rapport du comité de l’ONU sur les droits des personnes handicapées, il est dénoncé le fait qu’il y ait encore aujourd’hui en France dans ces établissement des pratiques de stérilisation forcée ou à l’insu des personnes. Il y a aussi le problème des réflexions du type : « mais comment tu vas faire pour t’occuper d’un enfant dans ton état ? » C’est nous qui savons si on est capable de faire quelque chose, pas les gens de l’extérieur.
Quand une femme handicapée devient mère, est-ce qu’il y a des difficultés particulières ? Par exemple, quand mon fils aîné est entré en CP, j’ai eu envie de le scolariser à l’école Ange Guépin, l’école Freinet. C’était hyper compliqué de l’emmener en transports en commun. Je me suis renseignée auprès de la Tan (ndlr : la société de transports publics) parce que je savais qu’ils ont des transports adaptés pour les personnes handicapées. On m’a dit : « non, c’est pour la personne handicapée qui peut éventuellement avoir un accompagnateur, mais c’est pas pour accompagner des enfants qui sont valides. » C’était pas possible et du coup j’ai dû renoncer à le scolariser dans cette école.Les dispositifs d’inclusion scolaire
Le titre « d’école inclusive » désigne tous les dispositifs destinés à accompagner les élèves « à besoin éducatif particulier » : les élèves handicapés mais également les élèves qui éprouvent des difficultés sociales ou/et scolaires ou encore les élèves allophones. On observe les mêmes mécanismes qu’importe le profil des élèves qui sont accompagnés : un manque de moyens, de personnels, de formation, mais aussi un rapport normatif et excluant à l’espace de la classe, qui entraîne une forte exclusion des élèves qui relèvent de « l’école inclusive ».
Les Ulis
Les Unités localisées d’inclusion scolaire sont une des modalités mises en place pour répondre aux objectifs de la loi de 2005 et de la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et programmation pour la refondation de l’école de la République qui a inscrit le concept de l’inclusion au sein de l’école.
Les Ulis ont succédé aux Upi, Unité pédagogique d’intégration, dans le secondaire en 2010, et aux Clis, Classes pour L’inclusion scolaire, dans le primaire en 2015 (1). On est passé du concept d’intégration à connotation socialisante au concept plus englobant d’inclusion. On sort alors d’une logique de classe spécialisée à celle de structure d’accompagnement. Un parcours Ulis école-collège-lycée apparaît de manière plus marquée. Les enseignant·es du second degré ont accédé à la spécialisation réservée aux personnels du 1er degré, titulaires du CAPA-SH, avec la création du certificat 2-CASH en 2005. Depuis 2017 tous les personnels enseignants passent le même certificat, le CAPPEI, certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap.
La présence de plus en plus nombreuse d’Ulis en particulier dans le second degré percute de plein fouet l’institution scolaire. On peut noter que les personnels enseignants, d’éducation, administratifs et techniques intègrent néanmoins peu à peu le concept d’inclusion scolaire en considérant les élèves handicapés comme des élèves à part entière qui partagent les mêmes espaces et temps de la vie d’une école ou d’un établissement, qui peuvent bénéficier des sorties scolaires ou projets, qu’on accompagne dans l’orientation. Les pratiques d’enseignement changent progressivement, des adaptations sont mises en place. L’inscription et la comptabilisation - relativement récentes sur tout le territoire - des élèves bénéficiant du dispositif Ulis dans les classes ordinaires ont contribué à ce processus.
Cela ne se fait pas sans grincement de dents ni tension entre et parmi les personnels extrêmement peu préparés ni formés à la prise en compte de tou·tes les élèves. Les AESH et les coordinateurs et coordinatrices d’Ulis, très peu aidé·es par l’institution, peuvent faire les frais de cette impréparation et rendre leurs conditions de travail compliquées. La libéralisation de l’école avec sa logique de rentabilité et le retour d’une idéologie conservatrice hostile au collège unique, viennent contredire le programme affiché d’inclusion.
Ce concept même est détourné par les pouvoirs en place et peut conduire à des situations de maltraitance institutionnelle. C’est au nom de l’inclusion scolaire qu’on réduit le temps d’accompagnement des élèves dans les classes ou qu’on augmente le nombre d’élèves inscrits dans chaque Ulis. La loi avait fixé ce nombre à 10 élèves, le nombre excède bien souvent aujourd’hui 14 au prétexte que les élèves suivent une partie des cours dans leur classe et sans tenir compte de l’accompagnement que cela nécessite pendant et après le temps dit d’inclusion. Le manque de places en Ulis par rapport aux besoins conduit à faire redoubler les élèves en attente, à les inscrire en classe ordinaire sans accompagnement ou à réduire leur temps de scolarisation en collège. La question de l’affectation dans la classe d’âge peut correspondre de ce point de vue aux besoins de l’élève, mais aussi être un moyen de le sortir plus rapidement du système scolaire.Comme les Segpas, les Ulis sont des dispositifs dont l’existence est vraisemblablement menacée pour des raisons financières au nom de l’accès à l’autonomie. Par exemple en 1980 plus de 95 484 élèves étaient inscrits en Clis pour un effectif de 53 056 en 2020 (2), le niveau le plus bas ayant été atteint en 2005 avec 39 830 élèves. Les élèves handicapé•es sont désigné·es désormais sous la même étiquette « élèves à besoins éducatifs particuliers » que les élèves en difficulté scolaire ou allophones, ce qui peut être une manière de nier le handicap et de supprimer progressivement les outils de compensation. Un livret d’accompagnement de ces élèves Bep est en train d’être mis en place ce qui peut avoir un effet ségrégatif. Le certificat du CAPPEI a introduit une nouvelle mission aux coordinateurs et coordinatrices d’Ulis de personnes ressources. Charge à eux et à elles de suppléer à l’indigence de l’administration en termes de formation et d’offrir expertise qui devrait être avant tout collective. On peut imaginer à termes qu’elles et ils soient affecté·es en classe ordinaire comme co-intervenant·es, ce qui entre dans la mission de personne ressource, jusqu’à ce que ces postes soient supprimés, comme le sont les Rased ou les maîtres supplémentaires.
Cette crainte ne doit pas nous empêcher de réfléchir à ce que pourrait être une école vraiment inclusive. L’hétérogénéité de fonctionnement des Ulis montrent qu’il y a matière. Certaines relèvent davantage d’une classe, d’autres d’un dispositif d’accompagnement. Il n’est pas évident ni pour les élèves ni pour l’équipe éducative de gérer cette double appartenance qui peut constituer dans le meilleur des cas une modalité constructive. Autre question : comment allier la réalité du handicap (ne pas savoir dénombrer à l’entrée au collège par exemple) et l’inclusion en classe ordinaire ? La disparition de cet espace réservé dont les élèves expriment le besoin - en non-mixité en quelque sorte - favoriserait-elle l’inclusion ? Comment éviter à contrario le risque de relégation qu’une Ulis peut constituer, et encore souvent ressentie comme tel par les familles ou les élèves ? On peut imaginer qu’une circulation plus ouverte et libre de tou·tes les élèves dans les écoles et établissements pourrait être une clé d’entrée. Comme la réorganisation du temps scolaire. La possibilité pour les élèves handicapé•es de se projeter en donnant aux personnes en situation de handicap une véritable visibilité et place dans la société aussi. L’inclusion ne doit pas être pour de faux. Or la disparition de nombreux CAP et du lycée professionnel au profit de l’apprentissage ainsi que le manque d’Ulis lycée laissent de nombreux élèves handicapé·es sur le carreau à leur sortie du collège sans autre perspective que le recours à la mission locale. Cette défaillance institutionnelle justifie d’amplifier les luttes syndicales pour une véritable inclusion scolaire des élèves handicapés•e.
C’est quoi une Ulis ?
Suite à la demande de leur famille, les élèves notifié•es ulis par la MDPH sont affecté·es par l’IA-Dasen. Elles et ils sont inscrit•es dans une classe de référence, dont illes suivent une partie des cours en fonction de leur PPS, projet personnalisé de scolarisation, qui est évolutif. Ils sont accompagné·es ou non par des Aesh ou l’enseignant·e spécialisé·e. Elles et ils passent une partie de leur emploi du temps dans la salle de l’Ulis, où est fait un travail de remédiation grâce à un accompagnement et un enseignement spécialisés.
En 2020 on compte 2,8 élèves handicapés scolarisés en classe ordinaire pour un élève en Ulis, la proportion était de 1,6 en 2004. « La part de la scolarisation collective augmente avec l’âge […] plus d’un élève [handicapé] sur deux. » (2) Les Ulis accueillent des élèves avec des handicaps très différents qui relèvent majoritairement de l’étiquette « déficience cognitive ou psychique ». Alors que 7 élèves ayant reçu une notification MDPH sont des garçons, la part est légèrement moins élevée en Ulis. Il y a peu d’Ulis spécialisées, hormis quelques Ulis dévolues au handicap moteur, sensoriel, de l’autisme ou les troubles du langage. Mais la tendance n’est pas à la spécification, d’autant que le handicap se présente souvent sous des formes variées, comme l’association d’un trouble dys et un trouble de l’attention.L’équipe de l’Ulis est constituée d’un.e ou deux Aesh-co, Aesh collective, et d’un coordinateur ou coordinatrice. Les Aesh-co, dont la mission requiert une formation particulière, accompagnent les élèves handicapé•es dans leur classe ou les autres lieux de scolarisation et viennent en appui de l’enseignant à l’ulis. Elles et ils favorisent les conditions de leur apprentissage. Les coordinateurs et coordinatrices exercent un enseignement spécialisé et contribuent au parcours d’orientation de l’élève, font le lien entre les différents membres de l’équipe éducative y compris les partenaires médico-sociaux avec l’appui de l’enseignant·e référent·e, servent de personne ressource pour les autres personnels.
La création d’une Ulis doit faire l’objet d’un vote positif en conseil des maîtres•es ou en conseil d’administration.Les élèves inscrit•es en Ulis école ne sont pas automatiquement affectée·s en Ulis collège et intègrent parfois une classe Segpa. À l’issue du collège la plupart des élèves intègrent soit un Im-pro (institut médicoprofessionnel), soit un lycée professionnel, soit un CFAS (CFA spécialisé).
Une Ulis, l’occasion d’apprendre autrement
Les Ulis sont l’occasion pour les élèves d’apprendre autrement et peuvent constituer pour les personnels des laboratoires pédagogiques. Comment apprendre à lire à un élève toujours non-lecteur ou non-lectrice à l’entrée au collège ? Un tel défi peut constituer un terrain de recherche. Une ulis est aussi un lieu d’observation qui permet de repérer des différences de fonctionnement cognitif peu réceptives aux méthodes d’enseignement traditionnel.
Le risque du dispositif Ulis serait de ramener le travail d’adaptation à un travail de simplification. Si cette simplification peut s’avérer nécessaire, c’est le fait de proposer des situations où l’élève est actrice et acteur de son apprentissage qui le conduit à progresser et à augmenter ses capacités d’abstraction. On pense au recours à la manipulation, aux jeux, à des situations de défis cognitifs, à l’expression orale, à l’explicitation. Les pratiques coopératives y prennent tout leur sens : « Moi je ne sais pas encore bien lire, mais je peux t’aider à dessiner un triangle » à travers un véritable échange de connaissances.1. Circulaire n°2015-129 du 21 août 2015
2. Repères et références statistiques, édition 2021, chapitre 3. ministère de l’Éducation nationaleLes RASED
Le RASED (Réseaux d’Aides Spécialisés pour les Élèves en difficulté) est un dispositif dont l’objectif est d’accompagner les élèves rencontrant des difficultés (durables et persistantes), au sein même de leur établissement (ou de leur classe), en complément et en collaboration avec l’enseignant·e de la classe. Le réseau regroupe des enseignant·es spécialisé·es (à dominante pédagogique ou rééducative) et des psychologues.
Les membres des RASED exercent sur un secteur d’école. Outre l’accompagnement des élèves, ils et elles assurent également des missions de « personne-ressource », mais également de relais entre école et famille, d’écoute d’enseignant·es en souffrance, d’accompagnement parental. Les personnels du RASED font partie des équipes pédagogiques des écoles de leur secteur et en cela participent à la vie de l’école. En zone rurale, ils et elles sont parfois le ou la seul•e interlocuteur ou interlocutrice professionnel•le dans des écoles isolées.
Une des forces du RASED, c’est d’intervenir dans l’école. De ne pas externaliser l’aide.
Une de ces faiblesses, c’est l’état déplorable dans lequel ses personnels exercent : manque cruel de postes, inégalités territoriales, prise en charge (très) partielle des frais de déplacement, détournement des missions par les IEN ou les DASEN etc etc...
Les RASED participent de notre école inclusive. Une école émancipatrice et plus égalitaire. Dans laquelle l’élève a droit à l’aide dont il a besoin, que ce soit par l’écoute, par l’accompagnement psychologique, par le jeu, par l’adaptation des contenus et des supports pédagogiques. Mais aussi une école dans laquelle les enseignant·es se sentent soutenu·es, valorisé·es et où l’entraide, la concertation et la complémentarité sont permises.
Les RASED disparaissent à petit feu, en silence. Ne les laissons pas faire. RASED is not Dead !
En pratique, pour celles et ceux qui ne connaissent pas les RASED : c’est une équipe composée (normalement) d’un·e psychologue de l’Éducation nationale, d’enseignant·es spécialisé·es à dominante pédagogique (ex-option E), d’enseignant·es spécialisé·es à dominante rééducative (ex-option G).
Dans les faits, il y a rarement de G, parfois un seul E et un psy.Dans de nombreux territoires, il n’y a plus de RASED.
Nous intervenons à la demande des enseignant·es (ou des familles parfois pour les psy), qui présentent les difficultés rencontrées par l’élève, ce qui a été mis en place, ce qui fonctionne ou pas.
Nous adaptons les modalités d’intervention en fonction des profils et des besoins des élèves : seul, en petit groupe, dans la classe, hors la classe. Nous faisons toujours le lien avec l’enseignant·e, les familles, l’ensemble de l’équipe. Nous adaptons surtout les stratégies d’accompagnement des élèves ; ce n’est pas du soutien, mais de la remédiation. Pour chaque élève, nous construisons un projet d’aide spécialisée, qui s’appuie sur les leviers, prend en compte les freins aux entrées dans les apprentissages et propose des stratégies «alternatives». Ce sont donc des missions complexes et complémentaires. Il y a aussi toutes les missions annexes, invisibles ; l’écoute d’enseignant·es en souffrance ou isolé·es (notamment en zone rurale), la médiation entre école et familles souvent éloignées de l’école, le lien avec les structures médico-sociales, l’’impulsion de projets transversaux etc etc.
Chaque année des postes sont supprimés, gelés, des psychologues contractuel·les sont nommé·es, les départs en formation sont inexistants dans de nombreux départements. Pas de formation, pas d’enseignant·es spécialisé·es, postes non pourvus, postes gelés, postes supprimés. Dont acte.
Exemple dans ma circonscription : 42 écoles, 6000 élèves, 1h30 de route d’un bout à l’autre de la circo = 2 psy titulaires / 1 psy contractuel (mais 1 psy en arrêt et 1 démission) ; 2 enseignantes E,1 enseignantes G. Impossible de traiter les demandes qui, en plus, sont centralisées par l’IEN et le Pôle Ressource, qui orientent les prises en charges, sans connaissance de terrain...Les segpa : interroger la dévalorisation constante
Les Sections générales et professionnelles adaptées jouissent d’une mauvaise image auprès des élèves et des parents, elles sont souvent perçues comme un déclassement scolaire qui priverait les élèves de perspectives. Les élèves accueillis au sein des SEGPA sont en situation de difficultés scolaires graves et persistantes; au-delà du terme qui peut heurter, cela signifie du retard dans les apprentissages principalement en français et mathématiques ainsi que dans le raisonnement fluide.
La SEGPA est une structure conçue initialement pour accueillir 64 élèves de la 6e à la 3e. Il arrive dans certains départements que l’on compte des SEGPA à 96 élèves. La SEGPA à 96 élèves suppose des adaptations et une organisation particulière qui pose la question des moyens.
Dans nombre de cas, les élèves orienté•es en SEGPA ont été pris en charge en élémentaire par les RASED maître·sses E pour de la remédiation et les équipes ont proposé aux parents de faire tester les élèves par le/la PsyEN EDA afin de constituer un dossier pour une affectation en SEGPA à l’entrée en 6e. La circulaire n°2015-176 du 28 octobre 2015 a sur le papier procédé à la suppression de la classe de 6e en SEGPA, cette classe devenant une classe de pré-orientation, dans les fait, cette classe est maintenue et le plus souvent les élèves peuvent commencer leur scolarité en SEGPA dès la première année de collège.
Comme pour le reste de l’enseignement spécialisé, les libéraux considèrent que la structure de la SEGPA coûte cher, puisque les élèves sont 16 maximum en enseignements généraux, elles et ils sont moins nombreux·ses en atelier pour des raisons de sécurité, en général des groupes de 8.
Chaque année, les listes d’attente des SEGPA sont importantes, comme pour le reste de l’enseignement spécialisé, les volontés d’économie préjudicient l’intérêt de l’élève. Grosso modo, si un·e élève n’intègre pas la SEGPA avant la fin de la classe de 5e, il est presque impossible qu’il ou elle l’intègre par la suite, ce qui revient souvent à dire que l’élève se retrouvera en situation d’échec et de dévalorisation face à ces derniers pendant sa scolarité au collège.
Dans le cadre de l’enseignement en SEGPA, il faut distinguer les enseignements généraux qui sont assurés par des enseignant·es spécialisé·es du premier degré ou du second degré titulaires du CAPPEI qui suivent les programmes du collège en les adaptant aux difficultés de leurs élèves. Et un enseignement en atelier assuré par des professeur·es de lycée professionnel dans le cadre de champ professionnel qui varient d’un établissement à l’autre (Espaces ruraux environnement, Vente distribution magasinage, Habitat, HAS,...). En 4e et 3e, les élèves de la SEGPA ont des périodes de stages en entreprise en lien avec les champs professionnels qu’iels suivent dans l’établissement. Les moyens d’enseignant·es sur la SEGPA sont pris en charge par l’Éducation nationale, la SEGPA a une dotation horaire globale qui est vu en Conseil d’administration comme la DHG du collège. Une des difficultés est de faire reconnaître que l’élève de SEGPA est un·e collégien·ne à part entière, la structure de la SEGPA est intégrée au collège.
Un des écueils sur l’ouverture de nouvelles SEGPA tient au financement des plateaux techniques des champs professionnels par les Conseil départementaux. Les crédits ne sont pas toujours dévolus aux modifications de structures des établissements. Ce qui freine l’ouverture de SEGPA pour faire face aux demandes des familles : même une ouverture progressive, en commençant par la sixième, suppose des travaux dans les deux ans. L’éducation contrairement à ce qui est affiché n’est pas une priorité de même que l’inclusion scolaire des élèves à besoin éducatif particulier.
L’enjeu de la SEGPA est de faire en sorte que les élèves qui sont accueilli·es malgré leurs difficultés soient considéré·es au sein de l’établissement comme des collégien·nes à part entière, et ce n’est pas toujours simple. La structure physique de l’établissement joue beaucoup, les équipes doivent souvent se battre pour que les locaux des enseignements généraux ne soient pas à l’écart du reste de l’établissement. Les élèves de la SEGPA ont une vie de collégien·nes semblable à celle des autres, les espaces communs aux élèves doivent être identiques, pas d’espace de cours spécifique pour les SEGPA par exemple. La SEGPA a vocation à accompagner l’élève dans la construction de son parcours et la reconstruction d’une estime de soi souvent très dégradée.
Les dispositifs d’inclusion pour les élèves allophones et pour les élèves peu ou pas scolarisés auparavant
Besoins particuliers et injonctions contradictoires
Si on examine les modalités de scolarisation mises en place pour deux catégories d’élèves dit·es à besoins particuliers, les élèves en situation de handicap et les élèves allophones, on observe une convergence dans l’organisation scolaire. En effet, on est passé pour les premier•ères de la CLIS à l’ULIS et pour les second·es de la CLIN (dans le primaire) de la CLA (dans le secondaire) à l’UPE2A. Ce passage de la dénomination de classe à celle d’unité formalise le fait que les deux dispositifs sont censés faciliter la scolarisation en classe ordinaire, cette scolarisation s’organisant en interne dans chaque établissement. Par contre, alors que les élèves orienté•es en ULIS le sont souvent pour un temps long et en tout cas non limité, les élèves qui bénéficient d’un enseignement-apprentissage spécifique en UPE2A disposent d’un temps institutionnellement limité avant une inclusion dite totale : 1 an et exceptionnellement 2 ans, notamment pour les élèves non ou peu scolarisé•es antérieurement. Cette limitation de temps accordé à un•e élève allophone pour apprendre une langue permettant de suivre des cours dans cette langue est donc un premier paradoxe dans la logique de l’école inclusive et du concept de besoin particulier. En effet, plusieurs recherches montrent un décalage de parfois plusieurs années qui existe entre le rythme acquisitionnel d’une langue à des fins de scolarisation et le rythme imposé par l’institution scolaire. Ainsi, à l’issue d’une année passée en UPE2A, très peu d’élèves parviennent à acquérir un niveau B1, niveau permettant de pouvoir suivre des cours complexes sans trop de difficultés. Si à l’école primaire, et notamment au cycle 2, cela ne pose pas trop de difficultés, dans l’enseignement secondaire cet impératif impacte négativement les possibilités de poursuite d’études des élèves allophones arrivant•es.Cette limitation de temps est justifiée au niveau ministériel et par les responsables académiques par la nécessité de ne pas condamner les élèves allophones arrivant•es à des dispositifs d’exclusion et à la ségrégation dans un établissement scolaire. Dans une perspective inclusive nous ne pouvons que souscrire à une telle volonté. Mais force est de constater que si elle ne s’accompagne pas de mesures volontaristes, les avantages de cette mesure sont avant tout comptables puisque cela permet d’économiser des postes d’enseignant•es en UPE2A et de récupérer des heures dans les DHG.
Les responsables académiques ont beau se donner bonne conscience en indiquant qu’au delà du temps accordé en UPE2A les élèves doivent continuer à faire l’objet d’une attention et d’un suivi particuliers, cela ne leur permet que de sauver leur face tout en faisant porter la responsabilité d’un tel suivi sur le dos des personnels.
Car dans les faits quels moyens sont donnés pour ce suivi ? Quels temps de concertation prévus institutionnellement? Quelles formations ? Pour les élèves allophones arrivant-es, au-delà du temps imparti en UPE2A, quel cadre autre que celui de la débrouille et du bon vouloir des personnels d’éducation ?La prise en compte des besoins spécifiques des élèves allophones arrivant•es, dans leur diversité et leur complexité, ne peut se faire sans moyens supplémentaires et plus particulièrement sans temps de réflexion et de travail commun dans l’établissement. Ce temps ne doit pas être un travail supplémentaire, ce doit être du temps dégagé sur les heures de service.
De même, laisser croire qu’on prend en compte les besoins éducatifs particuliers des élèves en imposant à tou·tes le même rythme n’est rien d’autre qu’une arnaque qui impose aux personnels que nous sommes la logique du travailler plus sans aucune compensation.
Le concept de besoins éducatifs particuliers, au-delà des contradictions du système, reste de toute façon un objet à interroger. Si l’adjectif éducatif a été ajouté c’est sans doute car dans la société capitaliste, il faut cloisonner les choses. Une approche holistique considérant tous les besoins de l’enfant risquerait de poser problème dans une société où on tolère que ces dernier·ères vivent dans des logements insalubres ou dorment dehors, soient ballotté·es d’hôtels en hôtels, enfermé·es en centre de rétention ou en prison. Pour que les contradictions entre les grandes déclarations de principe sur les droits de l’enfant et sur l’inclusion soient trop directement visibles, chacun·e s’enferme donc dans son pré carré et renvoie la balle à un autre service, un autre ministère. Un·e élève arrivé•e épuisé·e car un changement d’hébergement l’oblige à faire 1h30 de trajet ? Ce n’est pas du ressort de l’Éducation nationale et d’ailleurs si l’équipe pédagogique s’en mêle on ne tardera pas à lui rappeler, qu’il faut garder de la distance, ne pas trop s’investir, se protéger, … que ce n’est pas son boulot, toutes ces choses que celleux qui se sont engagé·es pour que leurs élèves aient des conditions de vie dignes se sont sans doute entendu dire un jour...
Ceci dit, même si on s’en tient à l’adjectif éducatif, le compte n’y est pas, et ce pour tous-tes les élèves dit·es à besoins particuliers. Dans des établissements où on manque de psychologues, de médecins, d’infirmier·ères, d’orthophonistes, de travailleur·euses du travail social, d’éducateur·trices spécialisé·es, de formation continue et de temps d’échanges institutionnalisés et de matériels ou aménagements architecturaux spécifiques, il est illusoire de penser que les besoins éducatifs des élèves sont réellement pris en compte de manière inclusive. De la même manière qu’il est illusoire de penser qu’une logique capitaliste, même celle qui se proclame aujourd’hui responsable, laissera autre chose que des miettes à celleux dont les besoins spéciaux nécessiteront des investissements économiques et sociaux conséquents pour parvenir à l’équité.
Les élèves non scolarisé•es ou peu scolarisé•es antérieurement, des exclu•es de l’école inclusive ?
De 1970 à aujourd’hui, les termes utilisés pour désigner les élèves qui arrivent en France en cours de scolarité ont considérablement évolué. Désigné·es tout d’abord comme « enfants étrangers » (circulaire de 1970), ils et elles deviennent des « enfants étrangers non francophones » (circulaire de 1973) pour finir en 1978 par être étiqueté·es « enfants immigrés ». En 2002, on parle d’ « élève nouvellement arrivé en France sans maîtrise de la langue française ou des apprentissages », désignation souvent réduite à son acronyme, ENAF, puis, depuis 2012 d’ « élève allophone nouvellement arrivé » ou EANA.
Cette désignation est toujours officiellement d’actualité mais depuis 2016 la direction de l’évaluation, de la prospective et des performances pour le ministère de l’Éducation Nationale a adopté pour les EANA une nouvelle définition : « Élève ayant des besoins éducatifs particuliers dans le domaine de l’apprentissage du français langue seconde ».
Cette catégorisation, si elle se situe dans le champ sémantique de l’inclusion, exclut de fait la question des élèves peu ou non scolarisé•es antérieurement dont les besoins ne sont pas seulement langagiers. Cette invisibilisation concerne des élèves qui arrivent avec leur famille de pays dans lesquels l’accès à l’école est difficile voire impossible mais aussi des enfants que la plupart des responsables politiques au gouvernement comme dans les collectivités locales aimeraient effacer du paysage : les mineur·es non accompagné·es, qui ont souvent été peu scolarisé·es, et les enfants qui vivent sur des campements ou dans des squats, à savoir les enfants rroms et les enfants de personnes dites migrantes.Pour elles et eux, on peut sans hésitation parler d’exclusion du droit à l’éducation et de maltraitance institutionnelle tant leur scolarisation relève d’un parcours d’obstacle. La première exclusion se fait souvent dès l’inscription, municipalités comme rectorats demandant fréquemment des papiers difficiles à fournir ou remettant en cause certains des documents qui leur sont présentés, notamment ceux concernant l’hébergement quand il y en a un.
Que des mineur·es non accompagné·es ou des enfants dont les familles sont sans domiciles fixes puissent intégrer un établissement scolaire fait donc partie des luttes qui, menées notamment par le réseau éducation sans frontière (RESF), réseau dans lequel SUD éducation est fortement impliqué depuis toujours, doivent s’amplifier.
Au-delà des maltraitances infligées aux mineur·es isolé·es et aux enfants sans domiciles, les enfants et adolescent·es qui arrivent en France en ayant été peu scolarisé•es sont aussi celles et ceux pour lesquel·les une inclusion effective dans des classes dites ordinaires pose le plus difficulté, leurs compétences étant souvent éloignées des attendus correspondant à leur classe d’âge.Pour ces élèves, un dispositif spécifique dit UPE2A NSA est mis en place dans le secondaire et est prévue la possibilité de rester plus longtemps en UPE2A. Même si dans les textes il est préconisé que ces élèves soient inclus dans des classes ordinaires, dans les faits leur scolarité peut être qualifiée de ségrégative, cette ségrégation s’élevant proportionnellement avec l’âge d’arrivée. Ainsi, en 2019, selon l’enquête de la DEPP, 15% des lycéen·nes allophones étaient scolarisé·es dans une classe spécifique pour allophones sans module de rattachement à un niveau scolaire, ce qui signifie donc sans inclusion. De manière générale, les dispositifs NSA dans le secondaire sont dans une sorte de vide institutionnel qui favorise selon les académies et établissements une mise à l’écart à la fois dans l’espace et le fonctionnement. Ils sont révélateurs du fait que placer un dispositif dans un lieu n’implique pas automatiquement la fin des mécanismes d’exclusions à l’égard des personnes pour lesquelles ce dispositif a été mis en place.
Les élèves non ou peu scolarisé·es antérieurement constituaient seulement 20% des EANA selon l’enquête DEPP 2019. Une minorité dans la minorité donc, ce qui favorise d’autant plus le fait qu’iels soient invisibilisé·es voire abandonné·es. De plus, les situations d’extrême précarité qui sont souvent les leurs, l’éparpillement géographique, le fait qu’iels n’aient pas forcément de langues communes pour communiquer et leur situation d’illettrisme font qu’il est difficile pour elleux comme pour leurs parents de se constituer en groupes agissant politiquement pour la reconnaissance de leurs droits.Il est donc important que les luttes pour une école inclusive prennent en compte leur existence et combattent radicalement les processus d’exclusion multiples dont ces enfants et adolescent·es font l’objet.
L’école et les discriminations linguistiques
L’histoire officielle des aménagements permettant de faciliter la scolarisation des élèves qui arrivent en France et/ou ne parlent pas français est relativement récente. Elle débute en 1970 avec une circulaire qui en instaurant des classes expérimentales d’initiation pour enfants étrangers (CLIN) institutionnalise un système mis en œuvre dès 1965 à Aubervilliers.
Avant cela, les élèves qui ne parlaient pas français étaient scolarisé·es dans des classes dites ordinaires mais souvent avec des élèves beaucoup plus jeunes (entrée plus tardive au CP, plus de redoublements). Il n’était pas rare que des élèves arrivant de l’étranger soient maintenu·es jusqu’à 13 ou 14 ans dans le primaire. Au collège, ces élèves étaient aussi plus souvent orienté·es par défaut dans des filières spécifiques pour accueillir des élèves en difficulté scolaire (SES, CPPN, CPA). Cette situation perdure encore aujourd’hui si on considère par exemple la surreprésentation des élèves issu·es d’UPE2A dans les classes SEGPA au collège et le fait que 61% des élèves allophones scolarisé·es en collège ont un retard d’au moins un an ou bien encore que 54% de ces élèves scolarisé·es au lycée le sont dans des filières professionnelles et notamment en CAP.
Dans un pays comme la France où le monolinguisme est depuis des siècles la norme institutionnelle et où la langue française est un instrument politique, parler une langue n’est non seulement guère valorisé, c’est aussi si cette langue est socialement et culturellement minorée, frappé de représentations négatives. Des théories telles que celles du handicap linguistique, associée à celle d’un bilinguisme qui serait additif versus un bilinguisme soustractif, ont donc trouvé un terrain favorable. Si ces théories ont rapidement été invalidées, la part des enfants ayant des parents non francophones était tout de même en 2006 l’un des critères retenus pour le classement en RAR (réseau ambition réussite). Actuellement, dans les représentations collectives de certain·es enseignant·es, le fait que des enfants parlent une autre langue que le français à la maison reste considéré comme une difficulté. Le fait d’avoir troqué officiellement la désignation « non francophone » contre celle d’« allophone », qui témoigne de la volonté de mettre en avant des compétences en langue étrangère non plus comme un problème mais comme une ressource éventuelle, n’y change rien.Une autre constante : les discriminations faites aux familles qui maîtrisent d’autres langues que le Français dans la communication scolaire. Pas étonnant que dans un pays où la maîtrise du Français est une condition à remplir pour pouvoir vivre en France, les questions de discrimination linguistiques et de droits linguistiques soit quasi absente du paysage politique.
Mis à part des efforts qui reposent sur des initiatives individuelles ou très localisées, rien n’est fait par exemple pour que des documents écrits soient traduits dans une langue comprise par les parents, ce qui constitue une difficulté et génère de l’exclusion pour des familles.
L’emploi exclusif du Français dans la plupart des situations institutionnelles, administratives et éducatives ne semble même pas remis en question dans le processus de réflexion sur la société inclusive et donc dans l’École inclusive. Dans cette perspective, l’usage de documents traduits en plusieurs langues ainsi que des budgets spécifiques pour avoir recours à des interprètes doit faire partie de nos revendications.
Les élèves allophones en situation de handicap ou gravement malades : quand un besoin particulier en éclipse un autre.
Parmi les élèves qui arrivent en France, un certain nombre sont porteur·euses de handicap. Logiquement, ce nombre varie proportionnellement aux arrivées. Parallèlement à cela, des familles viennent en France précisément à cause d’un handicap qui touche leur enfant et qui ne peut être correctement pris en charge dans le pays d’origine ou pour faire soigner une maladie pour laquelle un traitement n’y est pas accessible. Même si nous n’avons pas de chiffres officiels à donner, cela est particulièrement visible dans les métropoles où il y a des structures hospitalières spécialisées pour les enfants.
En UPE2A, nous constatons donc régulièrement que des enfants ont besoin de soins ou ont des besoins éducatifs particuliers qui relèvent de situations de handicap et pas seulement de la non maîtrise du français. Lorsque ce besoin est à l’origine de la migration, les familles sont alors dans une démarche de soins. Cette démarche est certes suspendue aux contingences administratives qui font que des personnes sans titre de séjour régulier ont des difficultés à se faire soigner correctement ou à faire soigner leurs enfants mais la question du diagnostic ne se pose pas. Les écoles et établissements font alors avec le handicap ou la maladie (souvent grave) de l’élève accueilli·e, son éventuel manque de prise en charge et les difficultés administratives qui vont avec toute demande de titre de séjour pour soin. Ces situations sont souvent révoltantes et permettent de constater à quel point les personnes étrangères, particulièrement quand elles ne sont pas riches et viennent de pays extra européens, font l’objet de mécanismes d’exclusion qui peuvent mettre leur vie ou celle de leurs enfants en jeu.
Dans d’autres cas, il n’a pas été question de handicap au moment de la scolarisation de l’élève. Soit parce que ce handicap ne s’est pas révélé, soit parce que la famille préfère le taire, notamment par peur d’être rejetée. Commence alors un processus de signalement et de diagnostic qui pour un·e élève allophone arrivant·e peut être long. En effet, le fait qu’un enfant ne parle pas ou peu le français est parfois mis en avant pour différer certains tests diagnostiques, notamment en ce qui concerne la dyslexie ou la dysphasie mais aussi en cas de troubles de l’apprentissage en général. Souvent le manque de moyens humains et notamment de médecins, d’orthophonistes et psychologues scolaires, en est la cause ainsi que le manque de formation et donc de compétences en clinique transculturelle de ces dernier·ères.
Il peut aussi y avoir des obstacles relevant du racisme (par exemple, enseignante en UPE2A, une médecin scolaire à qui je signalais un éventuel problème de vue pour un enfant m’a répondu qu’il ne servait à rien de tester la vue d’un élève rrom car de toute façon les rroms ne veulent jamais porter de lunettes!). Dans tous les cas, les élèves allophones semblent parfois appartenir à un régime d’exception où la recherche d’un trouble, première étape pour entamer de longues démarches de prise en charge, ne pourrait être initiée qu’après avoir résolu la question de la langue.
Il y a besoin, on le sait mais il ne faut cesser de le répéter, de plus de médecins et psychologues scolaires. Des postes d’orthophonistes doivent être créés au sein de l’Éducation nationale. Une offre de formation en clinique transculturelle et/ou en ethnopsychologie doit aussi être proposée à ces personnels. Il y a également besoin d’investir dans du matériel adapté. Par exemple, il existe un outil mis au point par une équipe du centre du langage de l’hôpital Avicennes pour détecter des troubles du langage dans la langue première. Cet outil, ELAL qui coûte environ 300 euros et nécessite lorsqu’il est utilisé, un recours à un·e interprète formé·e n’est de fait pas accessible et même très peu connu alors qu’il pourrait être mis à disposition dans les CASNAV.
À Paris, la question des élèves allophones arrivant porteur-euses d’un handicap ou souffrant d’une maladie invalidante est prégnante. Elle est régulièrement soulevée ces dernières années, notamment localement, mais aussi lors de rencontres qui ont lieu entre le DASEN du CASNAV et une intersyndicale composée par SUD, la CGT et la FSU ainsi que par la FCPE et RESF. Si elle continue à faire l’objet d’un vilain ping pong dans lequel les différents services se renvoient la balle comprenant à la fois le CASNAV, le service de l’école inclusive, l’ARS et les services sociaux, cette question, à force de volontarisme,ne peut plus être mise sous le tapis.
Toujours dans l’académie de Paris, en 2016, a même été créée une structure expérimentale UPE2A-ULIS dans un établissement du secondaire. Une chercheuse et un chercheur, Lucie Cadet et Martial Meziani ont mené une étude pour analyser ce dispositif (références à : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03557461/document).
Si la création de ce dispositif part d’un réel besoin et si son caractère expérimental laisse espérer des évolutions favorables, ce double dispositif semble aboutir à un espace qui fonctionnerait de façon fermée, l’enseignante de français et les AESH y travaillant évoquant même une forme d’exclusion de l’intérieur. Selon les auteur-es de la recherche, les élèves du dispositif UPE2A-ULIS sont dans “une situation particulière. Ni tout à fait inséré•es à l’école, ils et elles ne sont pas non plus exclus•e de celle-ci. De même, ils ne sont pas tout à fait des élèves allophones comme les autres, puisqu’ils sont volontairement mis à l’écart des dispositifs réglementaires. Enfin, ils ne sont pas toujours reconnus par la MDPH, les parents étant eux-mêmes en situation irrégulière. Ainsi, ils sont reconnus par le système scolaire, tout en étant exclus des droits sociaux, puisque leurs parents n’ont pas de numéro de sécurité sociale.”
Concernant les élèves allophones arrivant·es en situation de handicap ou atteint·es par une maladie grave ou invalidante et qui n’ont pas les moyens d’être soigné·es dans leur pays d’origine, la question administrative et sociale est souvent prégnante. Elle est même déterminante, continuité des soins et continuité de la scolarité passant trop souvent derrière des considérations administratives qui laissent les dossiers de reconnaissance de handicap et d’ouverture de droits sociaux en attente. Il y a aussi la question de l’hébergement. À Paris, des enfants malades ou handicapé·es inclu·es dans un établissement scolaire et entré·es dans un processus de soin dans des hôpitaux sont régulièrement déplacé-es par les services sociaux ou par la Préfecture et doivent régulièrement recommencer et réorganiser leur vie malgré leur handicap. Pour ces enfants-là, les communicant-es de l’École inclusive quand iels sont interpellé·es, répondent que ce n’est pas de leur ressort…. comme si leur conception de l’inclusion s’inclinait devant la logique des guichets des préfectures et les politiques racistes du ministère de l’Intérieur.
Fiche pour des écrits inclusifs
Quelques conseils pour écrire un texte inclusif.
1/ Texte
• faire des phrases courtes (2 propositions / 2 verbes au maximum)
• utiliser des mots simples et expliquer les mots compliqués, inhabituels
• utiliser le présent de l’indicatif
• regrouper ensemble toutes les infos d’un même thème avec un titre
• renommer les choses ou les personnes plutôt que d’utiliser des pronoms
• ne pas utiliser de métaphores, abréviations, initiales, acronymes2/ Caractères et police
• utiliser une police sans empattements, claire et facile à lire (Arial, Helvetica, Open sans, Tahoma)
• écrire en police 14
• utiliser la même police pour tout le corps du texte
• ne pas écrire en italique et ne pas souligner
• éviter les caractères spéciaux (&, #) et les abréviations3/ La mise en page
• aller à la ligne à chaque phrase
• aligner le texte à gauche, ne pas justifier le texte
• utiliser des puces pour faire des listes
• numéroter les pages,
• mettre en valeur les infos importantes (en gras, en encadrant...)
• aérer la page
• privilégier la lisibilité dans le choix des couleurs et des contrastes4/ Les images
• utiliser des pictogrammes
• utiliser des images qui illustrent votre proposGlossaire
AESHco : Accompagnant·e d’élève en situation de handicap à titre collectif
AESHm : Accompagnant·e mutualisé.e auprès de plusieurs élèves scolarisés en milieu ordinaire
CMP : Centre médico-psychologique
CMPP : Centre médico-psycho-pédagogique
ERSEH : Enseignant•e référent•e de scolarisation de l’élève en situation de handicap : il ou elle fait le lien entre les familles et l’ensemble des professionnels qui accompagnent l’élève en situation de handicap
IME : Institut médico-éducatif.
IM Pro : Institut médico-professionnel.
ITEP : Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (s’adresse surtout aux enfants et adolescent.es présentant des troubles importants du comportement)
PAOA: Programmation adaptée des objectifs d’apprentissage
PAP : Projet d’accompagnement personnalisé, s’adresse aux enfants avec des troubles spécifiques des apprentissages
PPS : Projet personnalisé de scolarisation (s’adresse aux élèves handicapés).
SESSAD : Services d’éducation spéciale et de soins à domicile.Le validisme, qu’est ce que c’est ? Comment le combattre au quotidien ?
Issu dans les années 2000 des disability studies, le validisme est un terme militant qui désigne un système d’oppression sociale que subissent les personnes handicapées. Ainsi, le Collectif Lutte et Handicaps pour l’Égalité et l’Émancipation (CLHEE) pose dans son manifeste la définition suivante : « le validisme se caractérise par la conviction de la part des personnes valides que leur absence de handicap et/ou leur bonne santé leur confère une position plus enviable et même supérieure à celle des personnes handicapées ».
Le validisme est composé de différentes oppressions: handiphobie (attitude de rejet et/ou de dégoût vis-à-vis du handicap), non-respect des droits des personnes handicapées (droits au logement, à l’emploi, à l’éducation, à la liberté de son mode de vie, à l’information, aux loisirs), inaccessibilité à certains espaces publics, sous-représentation dans les médias…Changer nos attitudes, petit à petit, contribuera à rendre la société moins validiste, mais cela ne suffira pas. Pour mettre fin à cette oppression, il faudra lutter pour plus d’accessibilité, la fin des discriminations et une réelle inclusion des personnes handicapées, à l’École comme dans la société en général
Sources :
- la définition du validisme par le CLHEE : https://clhee.org/2022/03/04/comprendre-et-lutter-contre-le-validisme/
- un article du CLHEE sur la lutte anti-validiste : https://clhee.org/2021/11/29/handicap-des-militants-a-lassaut-de-loppression-validiste/
- Petit guide sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient : https://www.ccite.fr/wp-content/uploads/guide-aveugles-web.pdf
- sur les poussages de fauteuil intempestifs : https://auxmarchesdupalais.wordpress.com/2019/06/02/lachemonfauteuil/
- une vidéo expliquant le concept d’handicap invisible : https://www.youtube.com/watch?v=p9UDX_sXJh4
- comment sous-titrer une vidéo https://www.24joursdeweb.fr/2019/comment-bien-sous-titrer-les-videos/Pour écrire cet article, nous nous sommes largement inspirées des bonnes résolutions anti-validistes des Dévalideuses disponibles sur leur site internet : http://lesdevalideuses.org/les-projets/bonnes-resolutions-anti-validistes/
NOS REVENDICATIONS
Pour les AESH
la titularisation sans condition de concours, d’ancienneté ni de nationalité de tou·tes les AESH dans un corps de fonctionnaire par la création d’un métier d’éducateur·trice scolaire spécialisé·e
•
l’augmentation des salaires avec une grille de progression salariale à l’ancienneté, un salaire minimum à 2200 euros bruts ( soit environ 1870 euros nets, primes et indemnités comprises)
•
l’accès à la prime REP/REP+ au même titre que les autres personnels
•
la reconnaissance d’un temps plein pour 24 heures d’accompagnement auxquelles s’ajoutent les heures connexes pour le travail de préparation, de suivi et de concertation
•
l’abandon des PIAL et de la logique de mutualisation
•
une véritable formation initiale et continue, sur temps de service
•
la création de brigades de remplacement pour assurer le remplacement des collègues absent·es
•
un droit à la mobilité, interacadémique et intra-académiquePour l'inclusion
des moyens pour accueillir et répondre aux besoins de tou·tes les élèves qu’importe leur situation scolaire, sociale, administrative, leur origine ou leur handicap… sur tout le territoire
•
la création massive de postes d’AESH, de RASED, de personnels médico-sociaux, d’enseignant·es, de CPE et de personnels de Vie scolaire et d’interprètes
•
la création d’un vrai statut de la Fonction publique d’éducateur·trice scolaire spécialisé·e pour les AESH
•
la baisse des effectifs par classe
•
une véritable formation initiale et continue à l’inclusion scolaire adaptée aux besoins des élèves et des personnels avec des temps de co-formation et de concertation pour tou·tes les personnels
•
l’adaptation des bâtiments et du matériel scolaire